
Guérison de l’hépatite C, quelle prise en charge après ?
Le traitement de l’hépatite C avec les nouveaux agents antiviraux à action directe (AAD) permet maintenant la guérison dans 95 % des cas quel que soit le génotype. Cette avancée thérapeutique majeure permet une amélioration significative de la survie et la diminution des complications hépatiques en comparaison aux patients non guéris. Néanmoins, même significativement diminué, le risque de complications hépatiques persiste, notamment le risque de survenue d’un carcinome hépatocellulaire (CHC). La prise en charge du patient guéri va donc dépendre du stade de la fibrose hépatique et en particulier du fait qu’il existe ou non une cirrhose.
Il est par ailleurs primordial d’identifier les facteurs susceptibles de faire progresser la fibrose hépatique malgré la guérison virologique : ainsi, la consommation d’alcool, l’existence d’un diabète ou d’un surpoids dans le cadre d’un syndrome métabolique sont clairement des facteurs aggravant la fibrose. Leur contrôle est donc primordial dans le suivi du patient.

Hépatite C, actualités thérapeutiques
L’hépatite virale C est une pathologie fréquente et potentiellement grave. 20 % des sujets atteints peuvent développer une cirrhose avec complications.
Le traitement antiviral de l’hépatite C, auparavant basé sur l’interféron, a été largement amélioré par l’utilisation d’antiviraux directs utilisés uniquement par voie orale. Ces molécules permettent une guérison de l’hépatite C dans plus de 90 % des cas avec un traitement d’une durée de 8 à 12 semaines. Alors que les effets secondaires des traitements précédents pouvaient être majeurs et limitaient leur utilisation, ces nouveaux traitements sont particulièrement bien tolérés. La grande majorité des patients peuvent dès à présent bénéficier de ces traitements quel que soit leur stade de fibrose.
Une éradication de l’hépatite C peut donc être envisagée dans les années à venir si l’accent est mis sur le dépistage des patients porteurs du VHC et qui l’ignorent.
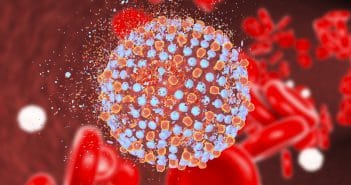
Place des marqueurs non invasifs de fibrose après l’éradication du VHC
Chez les patients ayant une infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC), la fibrose hépatique est un facteur pronostique majeur de l’évolution. Depuis 2015, grâce à l’association d’antiviraux directs de deuxième génération, l’éradication du VHC après traitement est désormais la règle. Après éradication virale au stade de cirrhose, bien que nettement diminué, le risque de carcinome hépatocellulaire persiste et représente l’enjeu essentiel de la surveillance.
Dans l’hépatite C chronique, plusieurs tests sanguins (FibroTest, FibroMètre, Hépascore) et la mesure de l’élasticité du foie (FibroScan) ont été validés en 2008 par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour estimer le degré de fibrose et la présence d’une cirrhose avant traitement. Toutefois, à l’heure actuelle, il n’est pas possible d’évaluer la régression de la cirrhose ou de la fibrose et de prédire le risque résiduel de carcinome hépatocellulaire après guérison virologique par un test non invasif de fibrose réalisé après le traitement antiviral. Une surveillance de la fibrose par les tests non invasifs est néanmoins nécessaire chez les patients ayant des facteurs associés de progression de la fibrose, tels qu’un alcoolisme ou un syndrome métabolique.

Editorial
Quel plus beau rêve en médecine que celui de voir…

Pathologie infectieuse et psoriasis
Les liens entre pathologie infectieuse et psoriasis sont très étroits. Ceux-ci sont certainement présents dans le déclenchement d’un psoriasis de novo ou d’une poussée de psoriasis chez un individu génétiquement prédisposé lors d’un épisode infectieux.
Ils sont également très présents aujourd’hui, à l’ère des biothérapies, dans ce type de traitement intervenant sur l’immunité et pouvant être responsable de complications infectieuses multiples et variées. Dans ce contexte, la prescription de ce type de médicament doit être faite avec beaucoup de précautions, notamment chez les individus porteurs ou atteints d’hépatite B, d’hépatite C ou du VIH.
Du fait de ces risques, une information claire et précise doit être apportée au patient ainsi qu’une bonne connaissance des vaccinations indiquées.

Fiche de dermoscopie n° 4
Cas clinique Il s’agit d’une fillette de 7 ans, de…

Diagnostics urgents des génodermatoses
Les génodermatoses ne relèvent pas en général d’urgences diagnostiques, excepté peut-être trois d’entre elles :
– le bébé collodion en raison d’une prise en charge néonatale spécifique évitant les complications ;
– l’incontinentia pigmenti en raison du risque neurologique devant un nouveau-né présentant un état de mal épileptique associé à une éruption vésiculeuse ;
– les épidermolyses bulleuses dont certaines formes peuvent être létales et nécessiter une prise en charge néonatale spécifique contre la douleur ainsi que des soins locaux adaptés.

Urgences en pédiatrie : les dermatoses infectieuses
Les pathologies dermatologiques sont une cause fréquente de venue aux urgences pédiatriques. Les dermatoses infectieuses représentent plus du tiers de ces pathologies. La plupart des patients ont une pathologie peu sévère. Cependant, certains patients vont présenter une infection grave pouvant engager le pronostic vital.
Le purpura fulminans, la fasciite nécrosante et les chocs toxiniques staphylococcique ou streptococcique sont des infections sévères nécessitant en urgence des traitements spécifiques. Certaines infections peu courantes telles que la méningococcémie chronique, la fièvre boutonneuse méditerranéenne ou l’ecthyma gangréneux ont des signes dermatologiques assez caractéristiques. L’expertise dermatologique permet d’évoquer précocement ces diagnostics, d’adapter rapidement le traitement et, dans certains cas, de réaliser des prélèvements microbiologiques cutanés ciblés pour confirmer le diagnostic.

Les urgences néonatales en dermatologie
Les urgences dermatologiques néonatales, survenant de la naissance à l’âge de 1 mois, sont rares. Cependant, elles nécessitent un diagnostic précoce et une prise en charge thérapeutique rapide et adaptée car le pronostic vital, le pronostic fonctionnel et/ou esthétique peuvent être mis en jeu. Il s’agit de dermatoses infectieuses dont certaines sont bulleuses ; de dermatoses bulleuses d’origine inflammatoire, carentielle, auto-immune ou génétique ; d’érythrodermies ou de troubles de la kératinisation diffus ; d’un dysraphisme céphalique ou spinal à risque infectieux ; de certains hémangiomes et autres tumeurs vasculaires à risque de complications, de nodules révélant une maladie systémique ou néoplasique.
Certains aspects cliniques sont propres à la période néonatale. Au moindre doute, une biopsie cutanée s’impose.

Editorial
Il y a des urgences en dermatologie ! Et tout particulièrement…





