
Le récepteur à l’antigène des lymphocytes T : structure, méthodes d’étude et fonctionnement (II)
Comme cela a été mentionné dans le chapitre précédent (Réalités…
Service de Dermatologie et Inserm U1058, Université de MONTPELLIER.

Comme cela a été mentionné dans le chapitre précédent (Réalités…
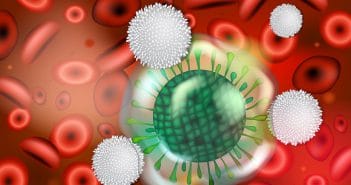
Le récepteur antigénique des lymphocytes T (T Cell Receptor ou…
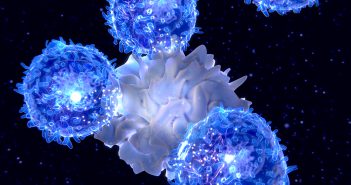
Les lymphocytes représentent le support cellulaire de l’immunité adaptative, d’activité…

Découverte par Metchnikoff en 1884, l’immunité innée fait partie, avec…

L’immunité innée est une première ligne de défense ancienne, non-spécifique, faite de diverses barrières et d’éléments peu spécifiques, mais très rapidement mobilisable qui permet la mise en place d’une défense tout à fait efficace avant que l’immunité adaptative, plus performante et plus spécifique, puisse se mettre en place.
Son importance est actuellement en pleine redécouverte, et ses mécanismes commencent à être nettement mieux identifiés, en particulier les récepteurs aux signaux de “danger” (TLR et NLR), la machinerie intra-cellulaire (signalosome) et les divers éléments de la réaction effectrice incluant les peptides antimicrobiens.
Comme toutes les zones frontières avec le milieu extérieur, la peau a mis en place une immunité innée très efficace qui fait intervenir notamment les kératinocytes, et qui est en équilibre délicat avec le microbiome cutané commensal en particulier le bactériome. Des anomalies de cette immunité innée sont de plus en plus souvent mises en évidences dans des affections cutanées inflammatoires, en lien notamment avec des anomalies qualitatives et quantitatives du microbiome cutané. La manipulation de l’immunité innée cutanée, tant à la hausse qu’à la baisse, représente une voie de recherche importante et riche d’espoirs.

La compréhension, le diagnostic et la prise en charge des lymphomes cutanés primitifs ont beaucoup progressé au cours des dernières années, avant tout pour les lymphomes cutanés T épidermotropes (LCTE, mycosis fongoïde [MF] et syndrome de Sézary [SS]). Les théories physiopathologiques se sont affinées de même que les méthodes diagnostiques, permettant une identification plus précoce. Des formes anatomocliniques toujours plus nombreuses et toujours plus trompeuses sont régulièrement décrites. Les scores pronostiques permettent de mieux anticiper l’évolution de la maladie et de proposer un traitement plus adapté. L’actualité thérapeutique est dominée par l’apparition de nouvelles possibilités locales mais aussi par la mise à disposition de nouveaux traitements plus “ciblés”, suivant en cela l’évolution générale de l’oncodermatologie.

Le microbiome cutané ainsi que l’immunité cutanée innée – couple…

La pemphigoïde bulleuse fait partie d’un groupe de huit maladies auto-immunes sous-épidermiques avec dépôts d’anticorps à la jonction dermo-épidermique. Elle a fait récemment l’objet de nombreuses publications qui ont contribué à éclairer le contexte épidémiologique, les facteurs déclenchants, les comorbidités (notamment neurologiques), les facteurs pronostiques, les différents aspects cliniques, les méthodes diagnostiques et les stratégies thérapeutiques. Il en ressort le profil d’une maladie polymorphe, à la physiopathologie probablement plus complexe que prévu et au pronostic redoutable pour de multiples raisons.
Si l’immunofluorescence directe reste l’examen diagnostique le plus pertinent, la recherche des auto-anticorps anti-BPAg2 est également intéressante, en particulier pour le monitoring immunologique de la maladie et donc de son traitement dont la durée n’est actuellement pas codifiée.
Les stratégies thérapeutiques doivent prendre en compte la fragilité de ces patients âgés et les traitements locaux ont démontré leur efficacité même s’ils posent des problèmes pratiques. La recherche de traitements “ciblés” innovants et bien tolérés est un enjeu majeur.

La pelade est une affection d’évolution prolongée bien souvent désespérante, tant pour le patient que pour le thérapeute. Son traitement est resté longtemps empirique, dominé par des mesures surtout anti-inflammatoires locales et/ou systémiques, dont l’évaluation ne conduisait pas à un niveau de preuve suffisant en raison d’une méthodologie parfois approximative. Plus récemment, les concepts physiopathologiques se sont affinés (notamment grâce au développement de modèles animaux) et ont permis de mettre en avant la théorie de la perte du “privilège immunitaire” du follicule pileux avec développement secondaire d’une auto-immunité à médiation essentiellement cellulaire. Cette hypothèse a permis de développer de nouveaux outils thérapeutiques plus conceptuels. Même si leur évaluation est encore balbutiante, certains d’entre eux semblent très prometteurs, en particulier l’interleukine 2 à faible dose, les statines, les inhibiteurs des kinases JAK1/2, les analogues des prostaglandines F2a, ainsi que (quoique probablement à un moindre degré) les inhibiteurs de phosphodiestérase et le plasma enrichi en plaquettes.
D’autres traitements, parfois plus anciens mais encore peu utilisés dans cette indication, peuvent également présenter un intérêt (laser excimer UVB311, ciclosporine, calcipotriol, etc). Dans tous les cas, les formes récentes et en plaques multiples demeurent plus facilement répondeuses, et ce plus longtemps que les formes diffuses et plus anciennes. L’enjeu principal sera méthodologique car le temps de l’empirisme est révolu, particulièrement pour des traitements coûteux et non dénués d’effets indésirables.

Les dermatoses neutrophiliques représentent une série d’affections inflammatoires cutanées assez disparates cliniquement mais qui ont en commun la présence exclusive, ou largement prédominante, de polynucléaires neutrophiles matures (PNN) dans les lésions histologiques. Elles font désormais partie d’un concept nosologique plus large de maladie(s) neutrophilique(s) qui intègre des lésions cutanées de tous types et des localisations viscérales, à rapprocher des maladies inflammatoires systémiques d’origine auto-immune ou auto-inflammatoires.
En dehors des cinq dermatoses neutrophiliques classiques dont les formes atypiques et frontières se multiplient, un certain nombre d’entités “nouvelles” ont été décrites au cours des denières années, souvent assez disparates et d’autonomie parfois douteuse. La notion d’associations morbides, notamment avec des hémopathies et diverses maladies inflammatoires, reste un point majeur et doit conduire à une grande vigilance clinique doublée de la pratique d’explorations systématiques éventuellement répétées.
Les possibilités thérapeutiques se multiplient en dehors ou en complément de la classique corticothérapie générale, mais il n’existe pour l’instant pas de recommandations précises.
