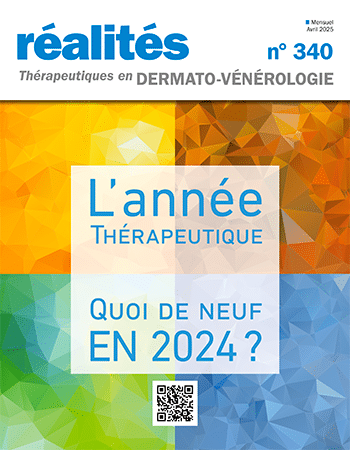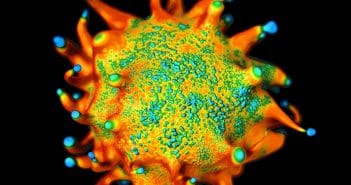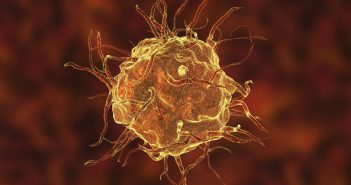
Quoi de neuf dans les histiocytoses de l’adulte ?
Les histiocytoses constituent un groupe hétérogène de maladies rares caractérisées par une accumulation de cellules dérivées du monocyte et du macrophage. Leur évolution clinique est extrêmement variable, allant de formes limitées et bénignes à des formes disséminées parfois létales.
Des avancées considérables ont été réalisées dans la compréhension de la physiopathologie des histiocytoses langerhansiennes (HL) et autres histiocytoses du groupe L, comme la maladie d’Erdheim-Chester (MEC) et l’histiocytose indéterminée (HI).
De grands progrès thérapeutiques ont été obtenus dans les formes sévères réfractaires d’HL et dans la MEC grâce à l’utilisation d’inhibiteurs de BRAF, en particulier le vemurafenib, et/ou d’inhibiteurs de MEK, permettant une survie prolongée.
Enfin, les progrès de la génétique tumorale ont permis de considérer l’histiocytose indéterminée comme une entité à part entière. Les lésions intéressent essentiellement la peau et peuvent être très affichantes. Il existe en revanche peu de nouveautés concernant les histiocytoses non langerhansiennes cutanéomuqueuses.