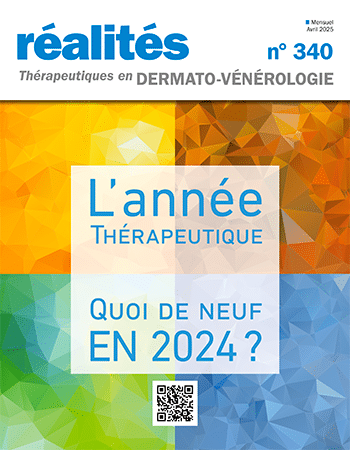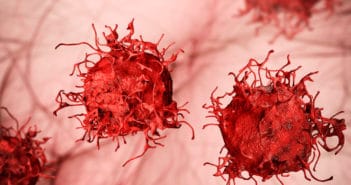
Quoi de neuf en pathologies tumorales cutanées ?
Même lors du premier confinement en mars 2020, où la sidération du système hospitalier a été réelle, l’activité hospitalière d’oncodermatologie a pu être maintenue malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19 : les traitements oncologiques ont pour la plupart été administrés et parfois optimisés. Toutefois, l’accès aux soins a été réduit en grande partie du fait de la crainte des patients, en particulier âgés, de se déplacer pour leurs consultations. Nous avons alors observé dès l’été 2020 une “vague” de patients avec tumeurs localement avancées dans cette population fragile, où une prise en charge précoce est pourtant cruciale.