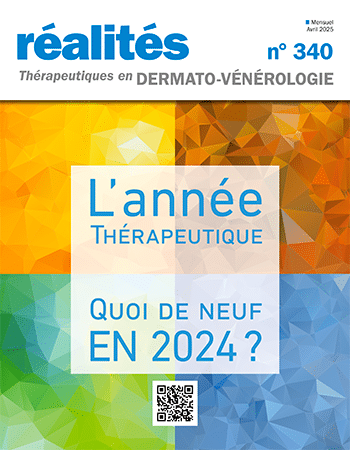Diététique en dermatologie
Les auteurs ont effectué une synthèse sur les effets des apports et régimes alimentaires dans certaines dermatoses incluant la dermatite atopique, le psoriasis, l’urticaire chronique, l’acné, les cancers cutanés épithéliaux et les mélanomes.
Si les apports et les régimes alimentaires ont fait l’objet de très nombreuses études, il existe encore peu de niveaux de preuves permettant de suggérer des recommandations alimentaires définitives pour les dermatoses étudiées. Il conviendra donc de privilégier une alimentation équilibrée avec des apports ou des évictions non délétères.

Dystrophies unguéales monodactyliques de l’enfant
Les mélanonychies longitudinales (ML) sont les dystrophies unguéales monodactyliques les plus fréquemment observées chez l’enfant, le motif de consultation le plus courant en pathologie unguéale de l’enfant. La ML de l’enfant nécessite un suivi puis une décision qui sera soit une surveillance au long cours, soit une exérèse chirurgicale pour surseoir à la surveillance prolongée.
Psoriasis et lichen striatus sont les dermatoses monodactyliques les plus courantes. La fréquence des onychomycoses, surtout des orteils, a augmenté chez l’enfant ; elle doit toujours être évoquée et confirmée par un prélèvement mycologique. Les tumeurs bénignes les plus fréquentes touchent plus souvent les orteils (exostose, fibrokératome) ; la radiographie est une aide importante au diagnostic.
La désaxation congénitale de l’ongle du gros orteil sévère et non résolutive est de traitement chirurgical vers l’âge de 8 ans. La fréquence de l’incarnation de l’ongle du gros orteil devrait être diminuée par des soins de pédicurie adaptés (ongle coupé carré, pas de coupe en biais).

Mélanonychie fongique : à propos d’un cas
La mélanonychie fongique est une présentation rare de l’onychomycose. Le principal diagnostic différentiel est le mélanome unguéal. Il est donc important de reconnaître l’origine fongique devant une mélanonychie, afin d’éviter un traitement chirurgical parfois mutilant.
Le patient observé est un homme âgé de 55 ans, présentant depuis 1 an une mélanonychie longitudinale du gros orteil gauche. À l’examen, il s’y associe une hyperkératose sous-unguéale et des stries transversales de la tablette unguéale. Le prélèvement mycologique a mis en évidence un Trichophyton rubrum nigricans. Le patient a été traité par terbinafine pendant 6 mois.
Devant toute mélanonychie, une origine fongique doit être discutée. Certains éléments de l’examen clinique permettent d’évoquer une onychomycose. La dermoscopie est très utile dans cette situation en montrant des images évocatrices d’onychomycose. Un prélèvement mycologique est nécessaire pour porter le diagnostic précis d’une onychomycose et proposer un choix thérapeutique adapté.

Lichen unguéal
Le lichen plan est une affection inflammatoire chronique pouvant affecter la peau et les muqueuses. Il intéresse l’appareil unguéal dans 10 % des cas. Assez peu d’études ont été consacrées à ce sujet.
L’aspect clinique est assez polymorphe du fait que le lichen peut atteindre le lit et/ou la matrice unguéale.
Le risque d’évolution du lichen unguéal vers des stades cicatriciels fibrosants définitifs à type d’anonychie
et de ptérygion justifie de savoir évoquer le diagnostic, de le confirmer par des biopsies adaptées et de mettre en place un traitement précoce. La corticothérapie par voie systémique orale ou intramusculaire constitue
le traitement de choix. Il est le plus souvent efficace au bout de 6 mois, mais les récidives sont assez fréquentes. Il reste à mener des études permettant d’évaluer le pronostic à long terme.

Prise en charge du mélanome de l’appareil unguéal
Il n’y a pas, à ce jour, de consensus dans la prise en charge du mélanome unguéal (MU). Plusieurs études ont pu démontrer que l’amputation agressive n’apportait pas de bénéfices en termes de pronostic vital et/ou de taux de survie en comparaison des traitements plus conservateurs. Le niveau de preuve de la majorité des articles sur le traitement du MU est très faible. Les données colligées d’études récentes suggèrent que le MU in situ peut être traité de façon adéquate par une excision locale large.
Dans le MU invasif, l’amputation reste recommandée, mais son ampleur doit être définie en tenant compte de l’épaisseur de la tumeur et la préservation de la fonction du doigt ou de l’orteil. De nouvelles études prospectives avec niveau de preuve suffisant sont nécessaires pour valider cette approche.

Intérêt de l’imagerie dans les tumeurs de l’ongle
L’imagerie est très souvent une aide au diagnostic de tumeur unguéale et à la préparation du geste chirurgical. Une radiographie permet de diagnostiquer une exostose sous-unguéale, lésion classiquement douloureuse aux multiples facettes cliniques, et d’éliminer une infection de l’os avant toute chirurgie. La tomodensitométrie est rarement contributive. L’échographie permet une exploration non invasive et sans radiations de l’appareil unguéal. L’épaisseur de la tablette, le siège lésionnel, son extension ainsi que l’activité tumorale peuvent être renseignés. C’est un examen à demander en première intention, l’IRM étant réservée aux cas équivoques ou non diagnostiqués par l’échographie.

Editorial
Il nous a paru utile de réaliser, avec ces quelques…

Aux confins de la dermatologie
Inhibiteur de la C1 estérase (ICE) : administration sous-cutanée efficace : un…

L’hyperhidrose, ou quand la chaleur ne fait plus suer
Avec une nette prédominance pour les zones axillaires, la prévalence…

Acné et antibiorésistance : mythe ou réalité ?
Propionibacterium acnes est une bactérie anaérobie impliquée dans la pathogénie de l’acné.
Ces dernières années, il a été constaté une nette augmentation des résistances aux antibiotiques utilisés dans l’acné. Cela représente un problème de santé publique, et des stratégies sont élaborées pour limiter ces résistances.