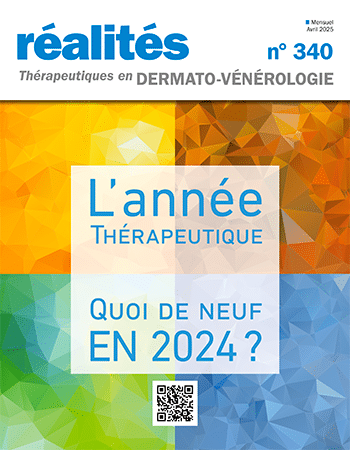Éditorial – Les phanères ont le vent en poupe !
Les enquêtes menées auprès de nombreux membres de différentes sociétés nationales et internationales de dermatologie ont montré qu’aujourd’hui les sessions les plus demandées et les plus appréciées sont celles traitant de cheveux et d’ongles. Jamais autant de sociétés n’ont présenté un nombre aussi impressionnant de symposiums, masterclass, forums… dédiés à ces annexes cornées.