
Les fils pilaires faciaux : signe cardinal de la démodécidose ?
Cet article illustre en photographies le signe clinique des lésions filiformes faciales diffuses, très fréquemment asymptomatique chez un adulte. Il pose le problème de sa signification diagnostique et thérapeutique en pratique quotidienne.

Lichen plan vulvaire
Le lichen plan érosif est la forme la plus fréquente de lichen plan vulvaire et nécessite dans tous les cas une recherche des autres sites potentiellement atteints.
Son évolution est chronique, souvent atrophiante, rendant à long terme le diagnostic différentiel parfois difficile avec un lichen scléreux.
Son traitement est long, difficile, imparfait. Il nécessite parfois de la physiothérapie (kinésithérapie vaginale manuelle ou avec une sonde) afin de lutter contre les synéchies vaginales très invalidantes.
Le lichen plan non érosif doit faire partie de la liste des dermatoses vulvaires érythémateuses et prurigineuses. L’atteinte des espaces interlabiaux présente toutes les caractéristiques du lichen plan cutané et son traitement corticoïde local est simple.

Alopécies des sourcils
Aussi utile dans son rôle de protection que dans l’expression du visage, quand le sourcil vient à manquer, la gêne est vite patente. De nombreuses pathologies peuvent être responsables d’une alopécie des sourcils, dont les causes classiques affectant les cheveux, qu’elles soient cicatricielles ou non cicatricielles, congénitales ou acquises.
Les sourcils peuvent toutefois être une zone de prédilection, voire apporter un signe diagnostique en faveur de certaines pathologies dermatologiques ou plus générales. Les traitements doivent être adaptés à cette spécificité topographique.
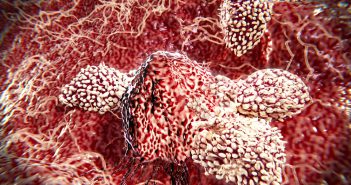
Toxicité cutanée des immunothérapies anticancéreuses
Les immunothérapies anticancéreuses anti-CTLA-4, puis anti-PD-1 et anti-PD-L1, ont modifié le pronostic des mélanomes. Leur mécanisme d’action explique probablement en grande partie leurs effets indésirables, notamment cutanés, de nature volontiers “auto-immune”. Bien que rarement sévères, ces derniers peuvent être majorés en fréquence et en sévérité dans le cas d’association de plusieurs molécules d’immunothérapie, qui est une voie de recherche actuelle.

Toxicité cutanée des thérapies ciblées anticancéreuses
Les thérapies ciblées anticancéreuses ont une toxicité cutanée fréquente et spécifique, différente de celle des chimiothérapies et immunothérapies (tableau I). De plus en plus, un avis dermatologique est sollicité pour la prise en charge des patients traités par ces molécules.
Il est donc important pour le dermatologue de connaître, de savoir évaluer ces effets secondaires cutanés et d’avoir des notions sur leur prise en charge, notamment les plus classiques comme les éruptions acnéiformes sous anti-EGFR, le syndrome main-pied sous anti-BRAF ou les paronychies sous anti-EGFR ou inhibiteurs de mTOR. Il s’agit véritablement de soins de support dermatologiques qui doivent permettre, dans la mesure du possible, de poursuivre les traitements dans l’intérêt du patient.

Complications cutanées des chimiothérapies anticancéreuses
Les effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses sont actuellement bien connus des oncologues. Cependant, l’arrivée de nouvelles drogues ou de nouvelles associations est à l’origine de nouvelles présentations cliniques.
Les alopécies, qui avaient la réputation de toujours repousser, sont parfois persistantes avec certaines associations utilisées dans le cancer du sein.
L’érythème toxique est un tableau parfois sévère qui doit faire discuter d’un éventuel arrêt ou au moins d’une baisse de posologie avec l’oncologue.
Le syndrome main-pied, différent de celui observé avec les thérapies ciblées, est souvent invalidant à cause des douleurs. Il peut cependant être prévenu efficacement.
Les relations entre radiations et chimiothérapies doivent être bien connues pour éviter des accidents sévères chez les malades recevant simultanément les deux types de traitement.

Editorial
Les différentes classes de médicaments anticancéreux sont responsables d’effets secondaires…

La cryolipolyse : une révolution prudente ?
La cryolipolyse est une des révolutions récentes du domaine de…

Les plantes qui agressent notre peau
De très nombreuses plantes peuvent agresser notre peau. Les lésions cutanées qu’elles provoquent sont regroupées sous le terme de phytodermatoses de contact irritatives pour les opposer aux phytodermatoses allergiques qui se produisent uniquement chez quelques individus.
Les mécanismes de cette irritation varient selon les plantes. Il peut s’agir d’une irritation mécanique comme avec les plantes à épines, tel le rosier, ou hérissées de poils plus fins, tels les glochides pour les cactus ou les trichomes pour l’orge, par exemple.
Certaines plantes contiennent des chimiques irritants comme l’oxalate de calcium (Dieffenbachia), le latex (Euphorbes), la capsaïcine (piments), les thiocyanates (moutarde)… D’autres, comme certaines plantes de la famille des Urticacées, sont capables de déclencher une réaction inflammatoire à type d’urticaire “mécanique”.
Enfin, plusieurs familles de plantes (Apiacées, Moracées, Fabacées et Rutacées) sont connues pour contenir des furocoumarines qui, sous l’action des UVA, déclenchent une réaction phototoxique. Les lésions cutanées varient suivant le mécanisme en cause mais ne sont pas spécifiques.

Hiérarchisation des traitements du psoriasis sévère en 2017
Le traitement du psoriasis sévère a clairement évolué en 2016 avec la commercialisation du premier anti-IL17, le sécukinumab. Des blanchiments presque complets (PASI 90 et 100) peuvent enfin s’observer. Toutefois, cette commercialisation suivie maintenant par une 2e molécule (ixékizumab) ne doit pas faire oublier certaines règles fondamentales : les topiques demeurent efficaces dans des formes peu étendues, les molécules orales sont souvent suffisantes, notamment le méthotrexate qui doit rester un traitement de 1re ligne si possible.
Évolution thérapeutique certes importante pour les traitements biologiques, mais la hiérarchie des traitements ne doit pas pour autant être bouleversée pour le moment.





