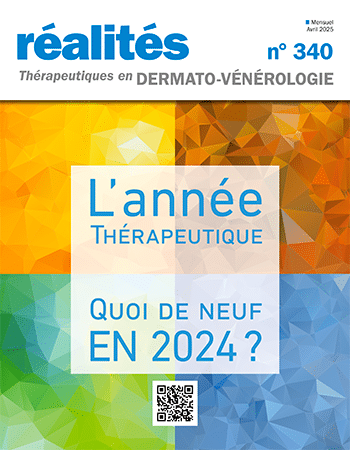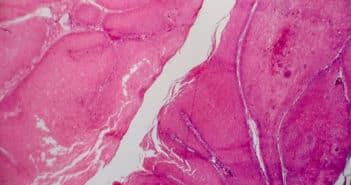Pendant longtemps, on a pensé qu’il existait une allergénicité croisée entre les pollens de graminées et les allergènes végétaux non polliniques présents dans les tiges et les feuilles des végétaux.
La publication de cas cliniques très particuliers comme l’allergie au jus de pelouse a permis d’expliquer certaines situations cliniques insolites par des réactions adverses, allergiques ou non, vis-à-vis des végétaux. C’est le cas de diverses réactions cutanées allergiques ou toxiques, de l’anaphylaxie associée à la pratique de la luge d’été, de certaines anaphylaxies après passage ou course dans des hautes herbes, des phytodermatoses dont le prototype est la dermite des prés. Il faut cependant éliminer les diverses anaphylaxies d’effort, l’asthme induit par l’exercice physique et les angiœdèmes récidivants.
Les syndromes inhabituels d’anaphylaxie décrits dans cette revue sont proches les uns des autres et certainement multifactoriels, survenant tout autant chez des individus non atopiques qu’atopiques, L’effort physique, le stress, les émotions, la chaleur, l’abrasion des téguments favorisant le passage transcutané des allergènes sont des facteurs associés qui aggravent les symptômes. En dehors de la dermite des prés, certaines de ces situations sont mal connues.