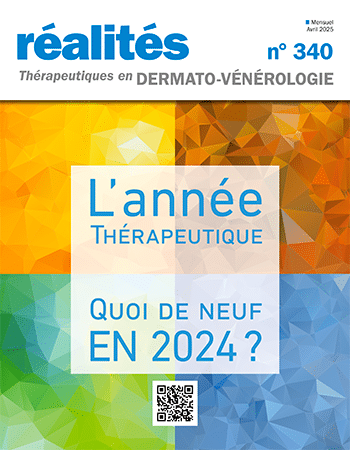L’environnement chaud, macéré et humide au sein d’une chaussure, combiné à l’exposition à divers allergènes potentiels (caoutchoucs, colles, colorants, agents tannants, sels de chrome, biocides, allergènes des plastiques, etc.) créent un environnement idéal pour le développement d’une dermatite allergique de contact (DAC). Sans oublier les allergènes potentiels liés aux traitements appliqués (excipients des topiques, corticoïdes, antiseptiques, antifongiques, etc.).
La DAC aux chaussures atteint la plupart du temps la surface dorsale des orteils (surtout l’hallux) ou le dos des pieds dans son entièreté.
L’atteinte plantaire est plus rare mais peut exister. En général, elle respecte la voûte plantaire. Une éruption vésiculeuse secondaire (située en particulier aux mains) peut s’observer.
La réalisation de tests épicutanés reste l’examen de choix du diagnostic de la DAC. En effet, le traitement principal réside en la découverte et l’éviction de l’(des) allergène(s) responsable(s).