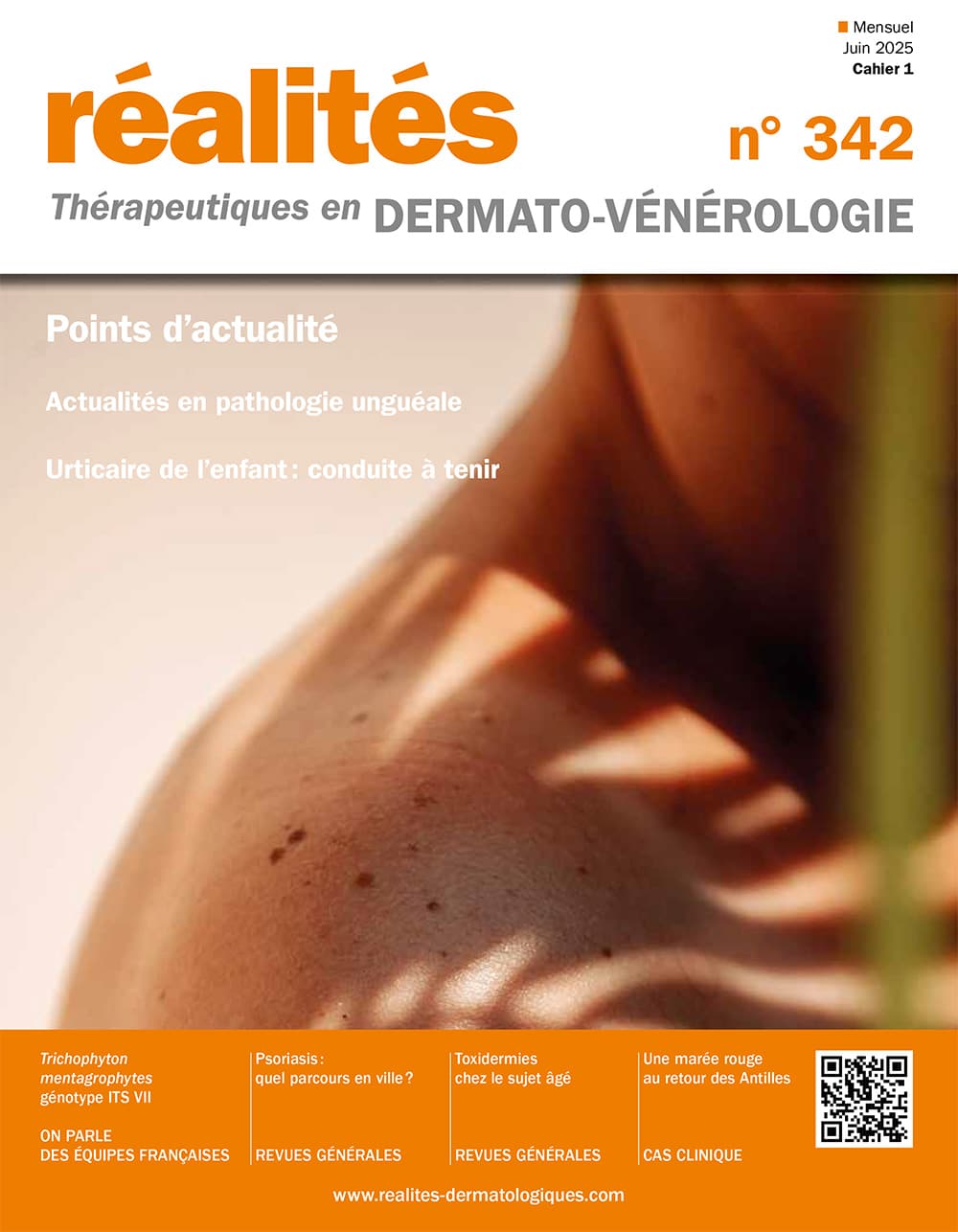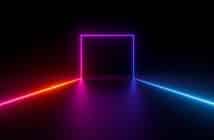Longtemps, les dermatologues ont dit en plaisantant qu’ils préféraient voir entrer dans leur cabinet un tigre plutôt qu’un patient atteint d’urticaire chronique. Ce temps est passé. La maladie perd progressivement de son mystère. Ses mécanismes physiopathologiques sont de mieux en mieux connus. Les dermatologues disposent à présent d’arbres diagnostiques et décisionnels fiables. Les armes thérapeutiques sont de plus en plus efficaces.
La terminologie a été revisitée depuis les dernières recommandations européennes. On ne parle plus d’urticaire chronique idiopathique, mais d’urticaire chronique spontanée. Les urticaires physiques sont regroupées dans la catégorie des urticaires inductibles.
Sur le plan physiopathologique, l’urticaire chronique est de plus en plus considérée comme une maladie auto-immune. Il a été mis en évidence des auto-anticorps IgG dirigés contre le FcRI et les IgE, et des IgE dirigées contre des auto-antigènes. Ces auto-anticorps se sont révélés fonctionnels : ils sont susceptibles d’entraîner l’activation des mastocytes et des basophiles. La connaissance de ces mécanismes physiopathologiques permet de comprendre comment l’omalizumab soulage les patients.
La stratégie du diagnostic est parfaitement expliquée par Emmanuelle Amsler. Elle se poursuit en 3 étapes. La première étape – le plus souvent facile pour un dermatologue – consiste à faire le diagnostic positif d’urticaire et à différencier l’urticaire chronique spontanée des urticaires chroniques inductibles. La deuxième étape valide la chronicité qui, par définition, correspond à des urticaires d’évolution supérieure à 6 semaines. Enfin, la dernière – et aussi la plus controversée – permet de faire un bilan et de rechercher une cause. Les recommandations actuelles proposent un bilan minimal. Sauf cas particulier de certaines urticaires aiguës récidivantes et intermittentes, qui peuvent parfois être confondues avec des urticaires chroniques, les bilans allergologiques sont inutiles. Il convient toutefois de ne pas s’endormir dans une douce routine thérapeutique et de garder son sens clinique éveillé au fil de la surveillance évolutive du patient afin de dépister une éventuelle cause.
Les grands principes du traitement de l’urticaire ont bénéficié de l’arrivée de nouvelles molécules et des recommandations européennes récentes. La démarche thérapeutique est clairement présentée par Angèle Soria. Elle repose sur une escalade thérapeutique avec, successivement, les antihistaminiques de nouvelle génération, les antileucotriènes, puis les traitements de troisième ligne que sont l’omalizumab, le méthotrexate ou la ciclosporine.
Enfin, je tiens à remercier amicalement le docteur Alain Briot, grand dermatologue clinicien aux multiples talents, qui m’a permis de reproduire une de ses œuvres.[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire