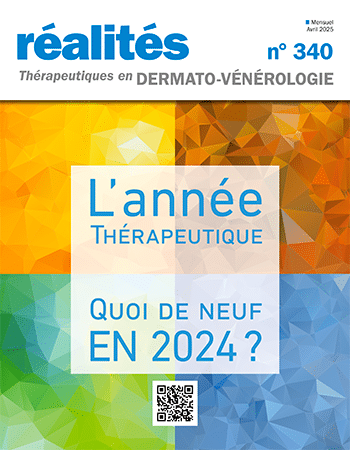La maladie de Kawasaki
La maladie de Kawasaki est une vascularite systémique aiguë d’étiologie indéterminée, associée à une atteinte des artères coronaires chez 25 à 30 % des patients non traités. Cette maladie touche presque exclusivement les enfants de moins de 5 ans.
La forme complète de Kawasaki est définie par l’association d’une fièvre d’au moins 5 jours, accompagnée de 4 ou 5 des critères suivants qui sont, pour la plupart, cutanéo-muqueux : un exanthème polymorphe, un changement des extrémités, un changement de la cavité orale et des lèvres, une conjonctivite non exsudative et une adénopathie cervicale d’au moins 1,5 cm. Les patients avec une fièvre prolongée et moins de 4 critères peuvent être diagnostiqués Kawasaki incomplet si une atteinte coronarienne est détectée à l’échographie.
La prise en charge initiale repose sur la perfusion d’immunoglobulines intraveineuses (IgIV) associée à de l’aspirine à dose anti-inflammatoire. Néanmoins, 10 à 20 % des patients ont une résistance aux IgIV et présentent un risque élevé d’anévrismes coronariens.
Le traitement en cas de résistance aux IgIV n’est pas standardisé : les options thérapeutiques sont une seconde perfusion d’IgIV, les corticoïdes, les inhibiteurs de la calcineurine, les anti-TNF et les anti-IL1.