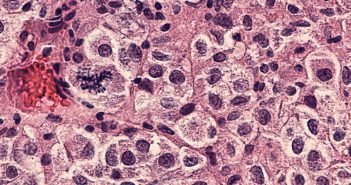“Nouvelles” entités dermatologiques : morceaux choisis
La dermatologie, discipline très descriptive de par la parfaite visibilité et l’accessibilité maximale des lésions, est particulièrement propice à la description de nouvelles entités souvent liées à des acronymes aux noms plus ou moins évocateurs et imagés.
L’intérêt réel de ces “nouvelles” entités (ou redécouvertes) est en réalité très variable (parfois assez modéré…). A priori, aucun critère d’intérêt n’est pour l’instant disponibles pour ces “nouvelles” lésions, ou regroupements symptomatiques quelquefois étonnants et rapportés avec enthousiasme faute d’étude rétrospective – ou mieux, prospective – de leur devenir par l’analyse de la littérature dermatologique dans la décennie qui suit leur description initale. Certaines sont probablement très rares, d’autres nettement plus communes mais posent alors souvent le problème de leurs limites nosologiques.
Quelques-unes de ces “nouvelles” entités ou concepts sont décrit(e)s, sélectionné(e)s sur des critères tout à fait subjectifs, la plupart ayant fait l’objet de communications et surtout de posters lors des Journées Dermatologiques de Paris au cours des dernières années.