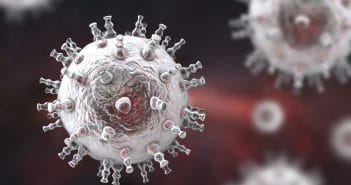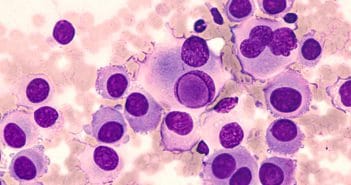Le mélanome en 2021 : que faut-il savoir ?
L’arsenal thérapeutique pour la prise en charge du mélanome ne cesse de se développer à la fois sur les classes de molécules actuellement disponibles, leur combinaison, en association ou en séquentiel, mais aussi sur leurs indications d’utilisation (mélanome métastatique, situation adjuvante ou néoadjuvante). Il s’agit d’un véritable changement de paradigme nous obligeant à repenser notre quotidien et celui des patients en termes de durée de traitement, de gestion des “flux”, de prise en charge des toxicités…
L’immunothérapie se démarque comme le traitement de première intention aujourd’hui dans le mélanome au stade avancé, mais des progrès sont encore à faire pour définir au mieux les stratégies de traitement, notamment chez des sous-groupes de patients restant malgré tout de mauvais pronostic (forte charge tumorale et LDH élevées). Le traitement adjuvant du mélanome est maintenant entré dans le quotidien de la prise en charge des patients à haut risque de récidive et il est en cours d’essai pour les mélanomes de stade II. L’intervention dès le stade néoadjuvant semble être une approche prometteuse.