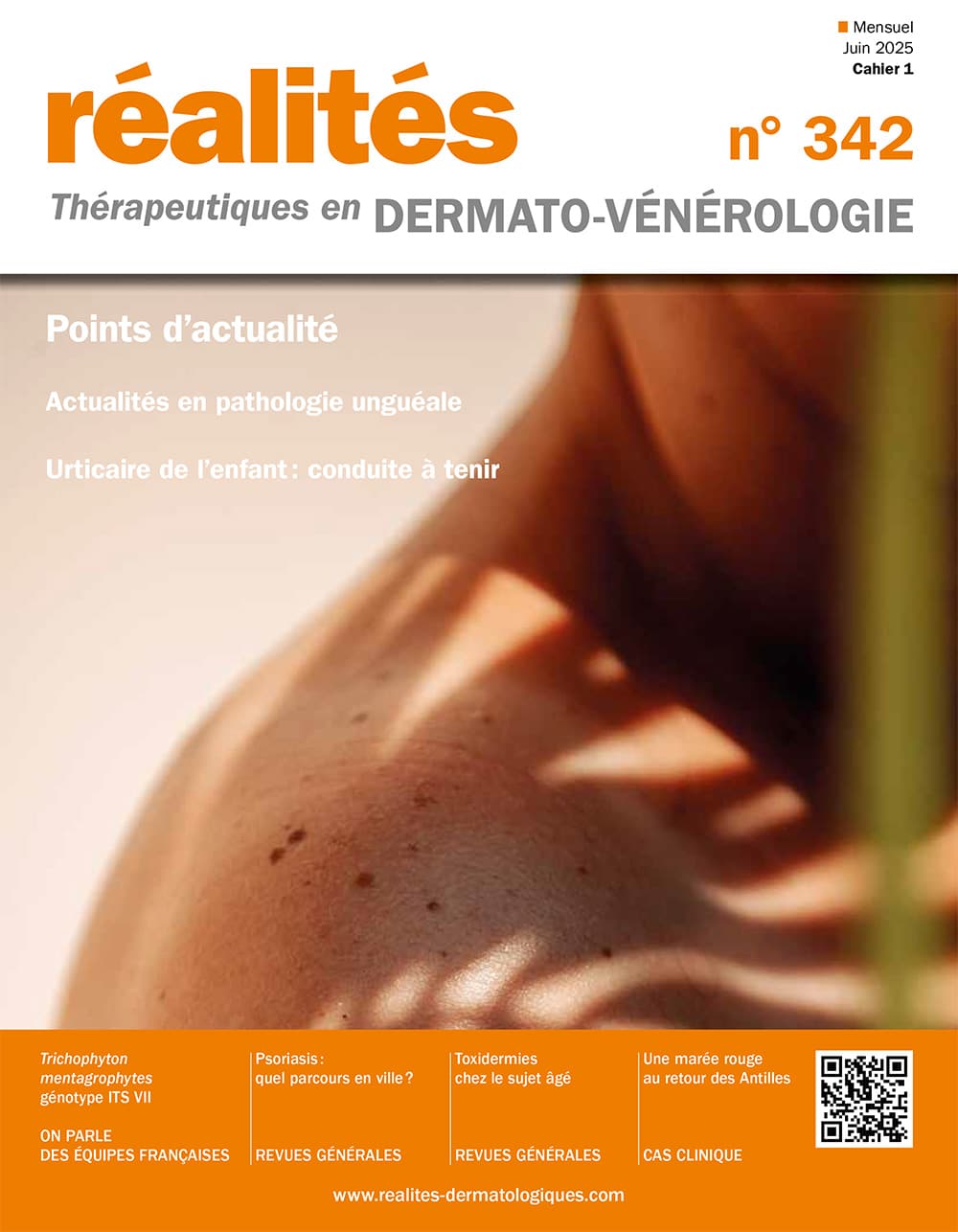Les infections de la peau et des tissus mous sont deux fois plus fréquentes que les infections des voies urinaires et dix fois plus fréquentes que les pneumonies. Pourtant, les formes graves sont rares, ne représentant que 2 % des infections amenant les patients en réanimation. Parmi ces formes graves, 60 % sont des infections nécrosantes, distinctes des autres du fait d’une indispensable prise en charge chirurgicale urgente. Les 40 % d’infections graves non nécrosantes le sont essentiellement par leur localisation engageant le pronostic fonctionnel (notamment en cas d’atteinte cervico-faciale) ou par leur retentissement systémique sur des terrains fragiles. On comprend donc aisément la grande difficulté diagnostique à laquelle sera confronté tout praticien, notamment dermatologue : il devra déceler parmi les très nombreuses infections cutanées peu graves les quelques formes susceptibles de mettre en jeu la vie du patient faute de prise en charge adaptée.
Nous nous concentrerons ici sur les infections nécrosantes de la peau et des tissus mous (INTM), dont la prise en charge est la plus spécifique (fig. 1).
Diagnostic
Malheureusement, du fait de l’hétérogénéité des terrains sous-jacents, des localisations anatomiques et des pathogènes responsables, les présentations cliniques peuvent être très diverses et insidieuses. Ainsi, les facteurs de risque d’INTM sont communs aux dermohypodermites non nécrosantes comme l’âge, l’obésité, le diabète, la consommation d’alcool ou l’immunosuppression. Par ailleurs, les signes cutanés francs sont inconstants et tardifs puisqu’on ne retrouve de nécrose cutanée superficielle que dans 23 % des cas, des bulles dans 44 % des cas et une crépitation sous-cutanée dans 5 % des cas [1]. Seule la moitié des patients présente un sepsis ou un choc septique. Des éléments qui doivent alerter précocement sont une douleur disproportionnée, par son intensité ou son étendue par rapport à l’atteinte cutanée superficielle, une évolution défavorable sous antibiotiques ou un retentissement systémique [2].
Aucun examen paraclinique ne permet à lui seul de confirmer ou d’infirmer le diagnostic. Aucune donnée solide ne sous-tend l’utilisation de la biologie, notamment l’élévation des CPK ou de la lactatémie, comme outil diagnostique fiable. De la même façon, bien que l’imagerie (IRM pour les atteintes des membres ou scanner pour les atteintes abdomino-périnéales ou cervico-faciales) puisse guider un geste chirurgical ou entrer dans un faisceau d’arguments dans les[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire