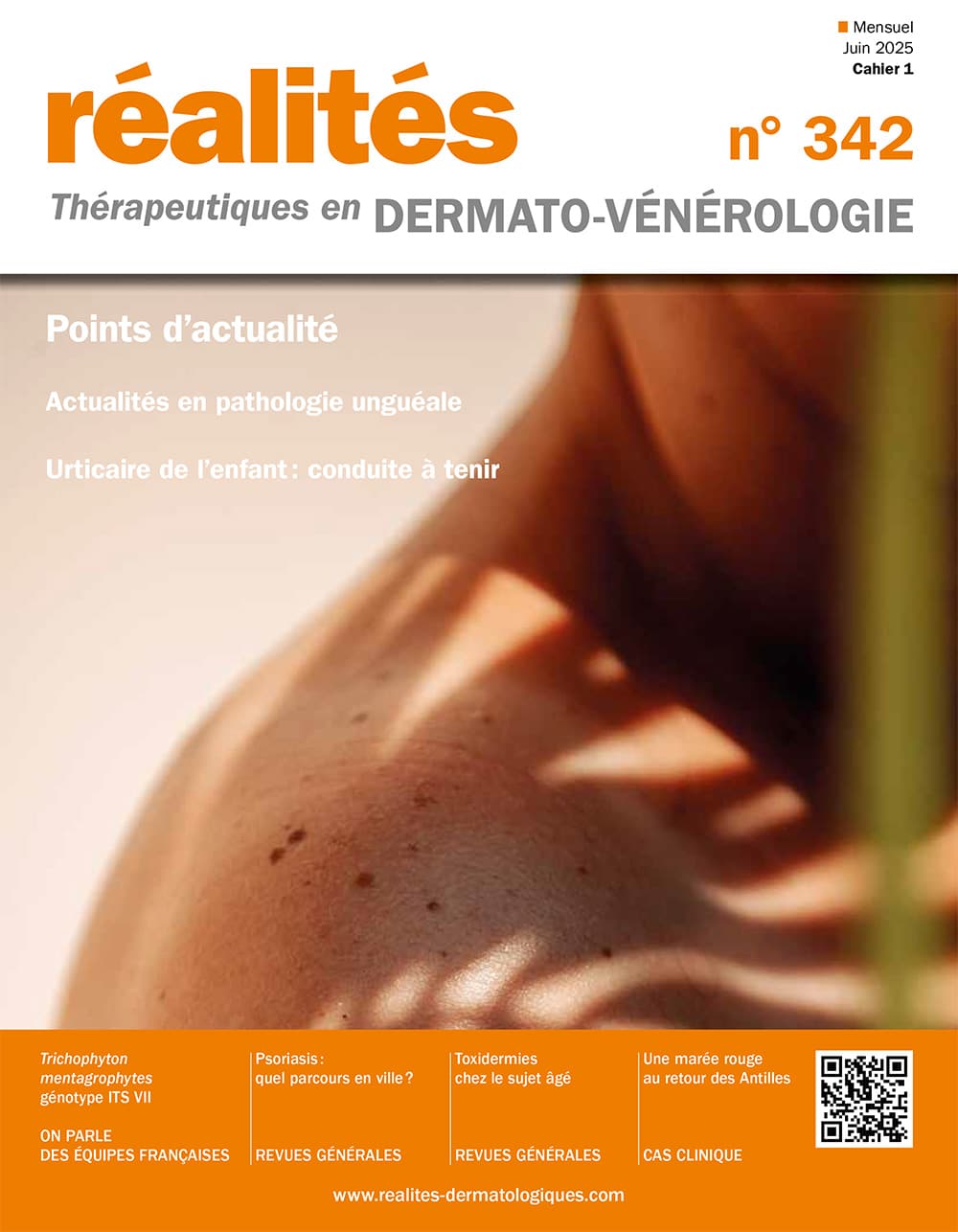Lorsque la peau est soumise à une source de chaleur localisée ou diffuse, deux principaux mécanismes de thermorégulation se mettent en place via l’activation du système parasympathique :
- la sudation, qui permet une perte de chaleur par évaporation, radiation, conduction et convection de l’eau ;
- la vasodilatation, qui intéresse principalement les plexus veineux.
Trois dermatoses directement liées à la chaleur seront détaillées : la miliaire sudorale, la dermite des chaufferettes et l’urticaire à la chaleur.
D’autres dermatoses sont classiquement aggravées par la chaleur, telles que les dermatoses acantholytiques (maladie de Grover, maladie de Darier) ou la dyshidrose. Les mécanismes expliquant cette aggravation restent mal identifiés.
La miliaire sudorale
Elle est secondaire à l’obstruction des glandes sudorales et survient classiquement lors de poussées fébriles ou au cours d’un séjour dans une atmosphère chaude et humide. En fonction du niveau de profondeur de l’obstruction du canal sudoral, on distingue 3 types de miliaire : cristalline, rouge et profonde [1, 2].
>>> La miliaire cristalline
Des vésicules de 1 à 2 mm (“gouttes d’eau posées sur la peau”) apparaissent de façon brutale et très transitoire. Non prurigineuses, elles siègent avec prédilection sur le thorax et l’abdomen. Le niveau d’obstruction est alors très superficiel (abouchement du canal sudoral à la peau, ou acrosyringium), responsable d’une vésicule intra- ou sous-cornée. La résolution est spontanée en quelques heures.
>>> La miliaire rouge
La miliaire rouge (“bourbouille”), dont la miliaire pustuleuse est un variant, se caractérise par de petites papulovésicules ou papulopustules rouge vif, extrêmement prurigineuses, siégeant sur la partie supérieure du tronc. Elle est liée à la rupture du canal sudoral dans la couche muqueuse de l’épiderme, entraînant une rétention sudorale intraépidermique responsable d’une réaction inflammatoire locale importante. L’évolution est habituellement plus longue, en quelques jours, avec une desquamation puis une hypohydrose transitoire. Une évolution plus prolongée (2 à 3 semaines) a parfois été rapportée. Le traitement repose avant tout sur l’éviction de la chaleur et de la macération.
>>> La[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire