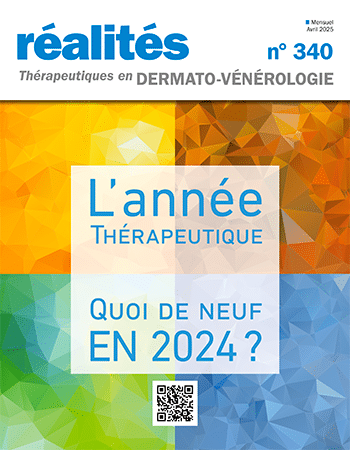Acné de l’adolescent : actualités
L’acné touche 85 % des adolescents (12-25 ans). À cette période de la vie, elle peut avoir un impact très important sur l’image de soi, la confiance en soi et sur la relation avec les autres. Elle expose aux risques de stigmatisation, dysmorphophobie et cosmétorexie.
Au travers d’études descriptives récentes, il a été observé que les adolescents recherchent des informations sur l’acné en questionnant leur famille, leurs amis mais aussi et surtout via les réseaux sociaux. On sait que l’information sur ces réseaux n’est pas toujours validée, ce qui peut véhiculer des croyances incomplètes voire erronées comme, par exemple, que l’acné est liée à un défaut d’hygiène. Par ailleurs, ces études montrent que leur connaissance de l’acné est partielle : les ados pensent souvent que l’acné est transitoire et non une pathologie chronique.