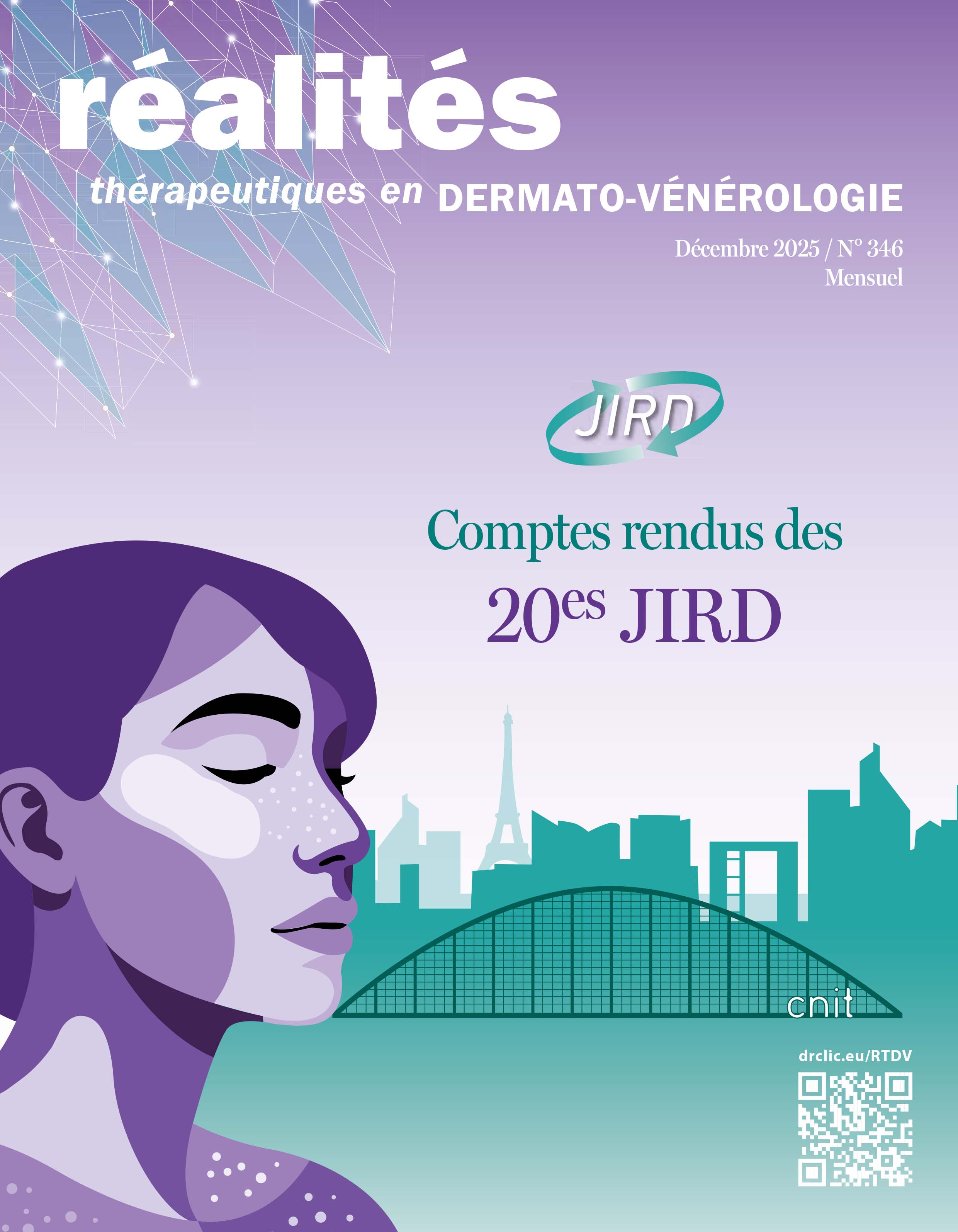Aspects cliniques et thérapeutiques des vascularites cryoglobulinémiques
Les vascularites cryoglobulinémiques se manifestent par des signes généraux, des lésions cutanées à type de purpura (voire d’ulcères ou de nécroses distales), des arthralgies, des neuropathies périphériques, des glomérulonéphrites membrano-prolifératives et, plus rarement, des atteintes cardiaques ou digestives. Les cryoglobulines de type I sont le plus souvent liées à une hémopathie (myélome, lymphome B) ou à une MGUS (gammapathie monoclonale de signification indéterminée). Les cryoglobulines mixtes (types II et III) sont le plus souvent associées à une hépatite C (> 90 % des cas), moins fréquemment à des maladies auto-immunes (lupus, syndrome de Gougerot-Sjögren) ou à une hémopathie lymphoïde B. Le traitement des vascularites cryoglobulinémiques dépend de l’étiologie sous-jacente (virus de l’hépatite C, myélome, lymphome, connectivite…), du type de cryoglobulinémie (type I versus types II et III) et de la sévérité des symptômes. Dans les cryoglobulinémies mixtes, le traitement d’éradication du virus de l’hépatite C (VHC) doit toujours se discuter. Le rituximab est l’agent immunomodulateur le plus efficace et doit être réservé aux formes sévères.
Dans les cryoglobulinémies de type I, le traitement sera celui de la maladie hématologique sous-jacente. Les traitements comprenant en particulier le bortézomib, le thalidomide, le lénalidomide ou un agent alkylant semblent intéressants dans le cadre des MGUS et sont à discuter en fonction de la sévérité de la vascularite. Les plasmaphérèses sont un traitement d’appoint intéressant dans les vascularites cryoglobulinémiques sévères et/ou réfractaires.