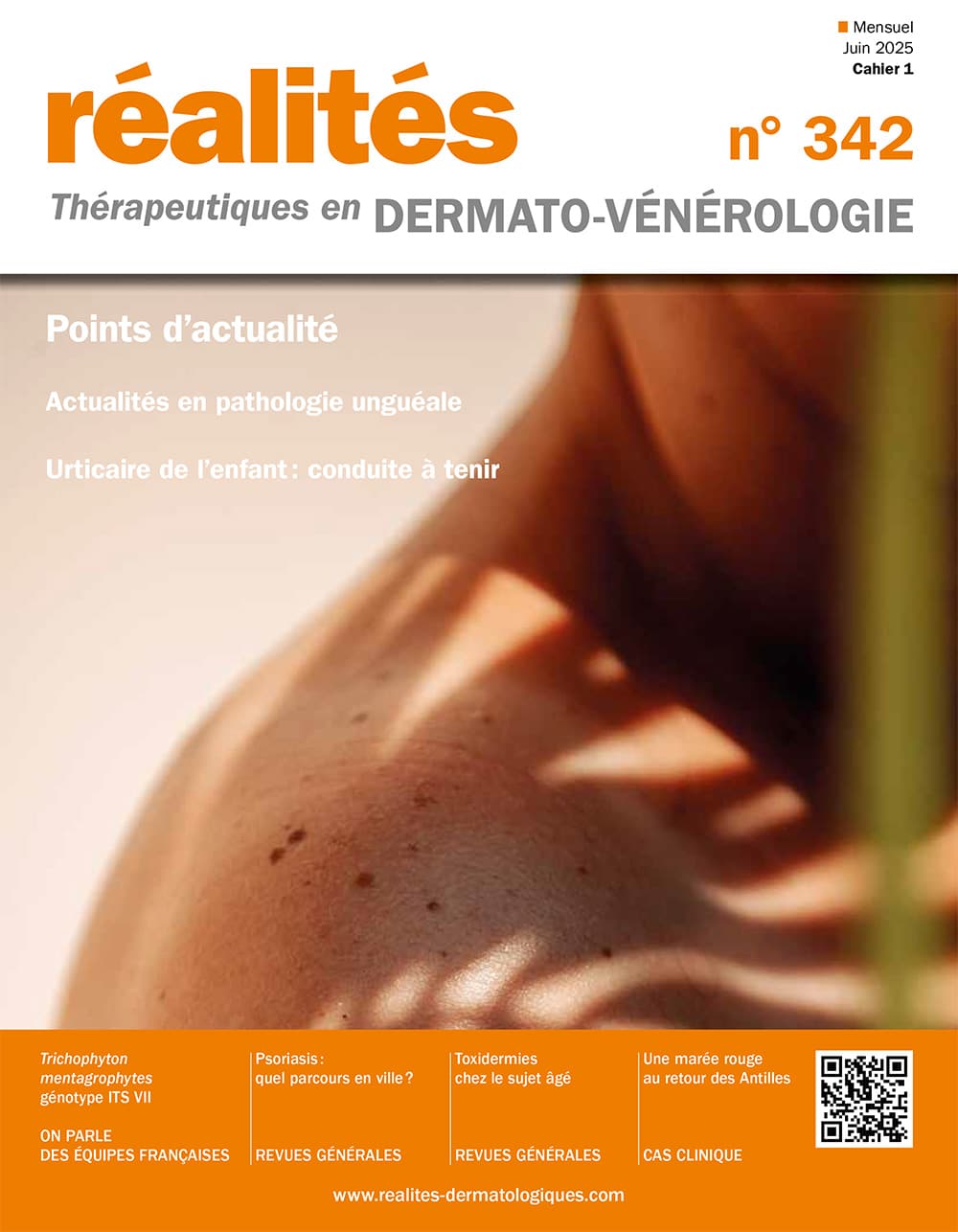Les maladies dermatologiques inflammatoires ou auto-immunes touchent souvent des femmes en âge de procréer. Or, en cas d’atteinte sévère, ces maladies inflammatoires/dysimmunitaires peuvent avoir un effet délétère sur le déroulement de la grossesse. Un contrôle de la pathologie est donc nécessaire avant d’envisager une grossesse. Les biothérapies sont des traitements innovants, avec une bonne efficacité. Cependant, compte tenu de l’absence de données de tolérance au cours de la grossesse, certains traitements devront être arrêtés précocement au diagnostic de la grossesse et/ou pour l’allaitement (tableau I) [1].
Biothérapies du psoriasis
Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique avec une prévalence de 3 à 4 % en Europe de l’Ouest, atteignant principalement la population adulte avec une distribution bimodale : un premier pic entre 18 et 40 ans et un deuxième pic entre 50 et 69 ans [2, 3]. Il atteint donc de nombreuses femmes en âge de procréer. La grossesse a un impact imprévisible sur l’évolution du psoriasis mais semble habituellement l’améliorer : 55 % des patientes sont améliorées lorsqu’elles sont enceintes, 21 % sont stables et 23 % s’aggravent [4].
Par ailleurs, il semble qu’un psoriasis sévère non traité au cours de la grossesse soit associé à un risque de retard de croissance intra-utérin ou de nouveau-né avec “petit poids pour l’âge gestationnel” (PAG), rendant nécessaire le traitement des patientes avec atteinte sévère [5]. En effet, il a été décrit la présence de multiples thrombus intraplacentaires alors même que le bilan de thrombophilie était négatif chez des femmes devant arrêter leur grossesse compte tenu du retard de croissance intra-utérin. L’hypothèse de vasculopathie placentaire secondaire à la présence en trop grand nombre de cytokines pro-
inflammatoires est discutée [6].
De nombreuses biothérapies sont aujourd’hui disponibles, regroupées en quatre classes thérapeutiques : les anti-TNF (adalimumab, étanercept, infliximab, certolizumab), les anti-interleukines (IL) 12/23 (ustékinumab), les anti-IL17 (sécukinumab, ixékizumab, brodalumab, bimékizumab) et les anti-IL23 (guselkumab, risankizumab, tildrakizumab). Ces traitements ont montré une meilleure efficacité que les[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire