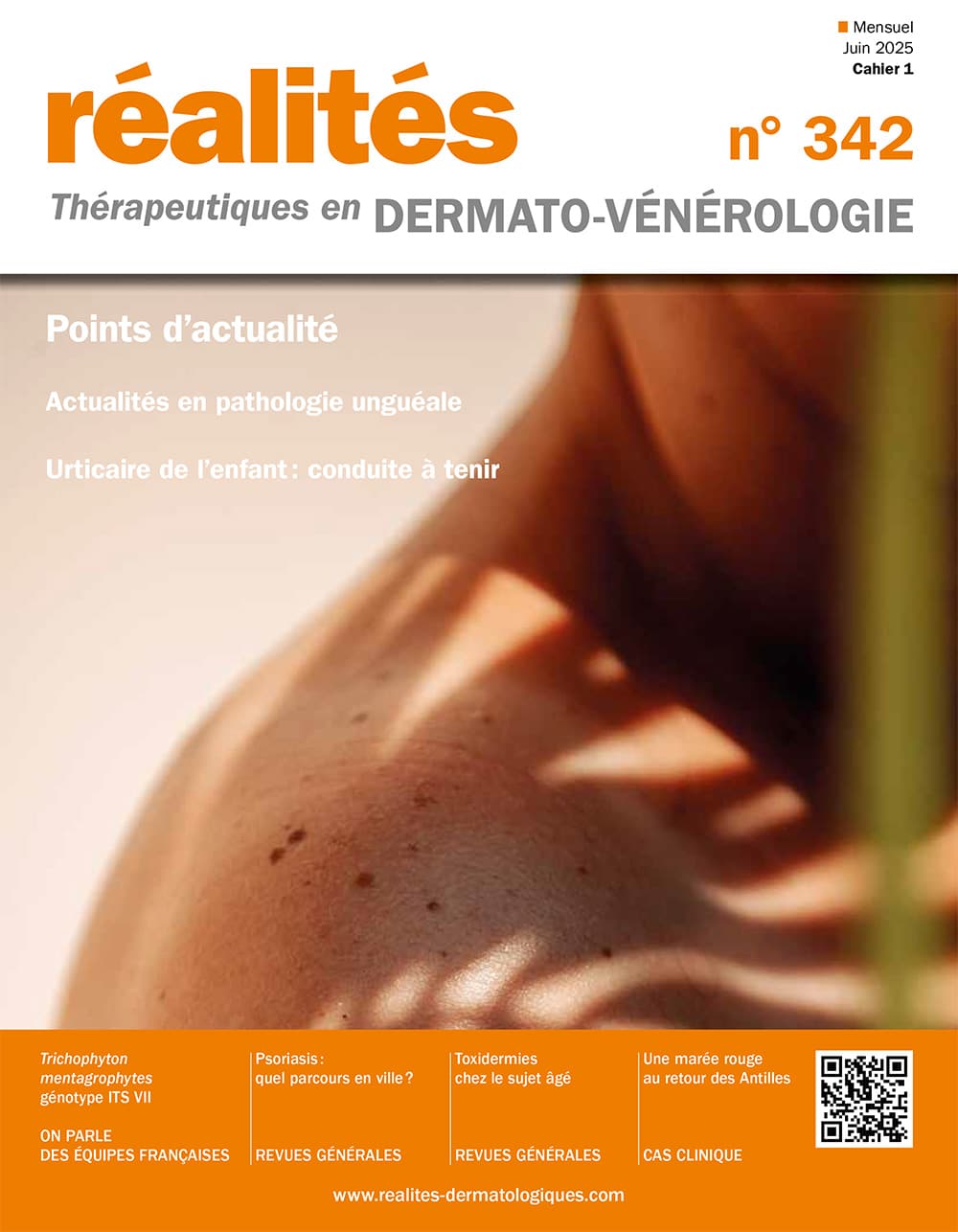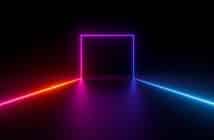Les antibiotiques constituent le traitement classique de première intention de l’hidradénite suppurée (HS). Ils ont été proposés initialement de façon empirique ou par analogie à ce qui se faisait dans d’autres pathologies inflammatoires, comme la cellulite disséquante [1, 2]. Ces stratégies s’appuyaient essentiellement sur l’analyse de prélèvements bactériens le plus souvent superficiels, mettant en évidence une flore polymicrobienne peu informative. Les durées de traitement, la nature des molécules et des bactéries à cibler restant mal définies, de très nombreux protocoles se sont développés sans véritable consensus.
Des études récentes ayant porté sur de larges effectifs et la publication des nouvelles recommandations françaises de la Société française de dermatologie sur les traitements de l’HS [3] permettent de dégager une ligne de conduite plus consensuelle. Nous verrons dans cette revue les principales stratégies d’antibiothérapie, avec un focus sur les recommandations françaises.
“Cibles” bactériennes et stratégies de traitement
L’HS n’est pas une maladie infectieuse au sens classique du terme : aucun germe spécifique n’est identifié et il s’agit d’une pathologie chronique qui évolue par poussées entrecoupées de rémissions. Sur le plan microbiologique, plusieurs études, notamment métagénomiques, ont confirmé l’existence d’une dysbiose cutanée, avec des variations du microbiote en fonction des stades de sévérité de la maladie [4, 5].
Mais le rôle de cette dysbiose dans le développement des lésions d’HS reste débattu : source d’inflammation à l’origine d’une réponse immunitaire inadaptée ou conséquence d’un état pathologique inflammatoire préexistant ? Les analyses microbiologiques locales sont le plus souvent polymicrobiennes et ne mettent parfois en évidence[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire