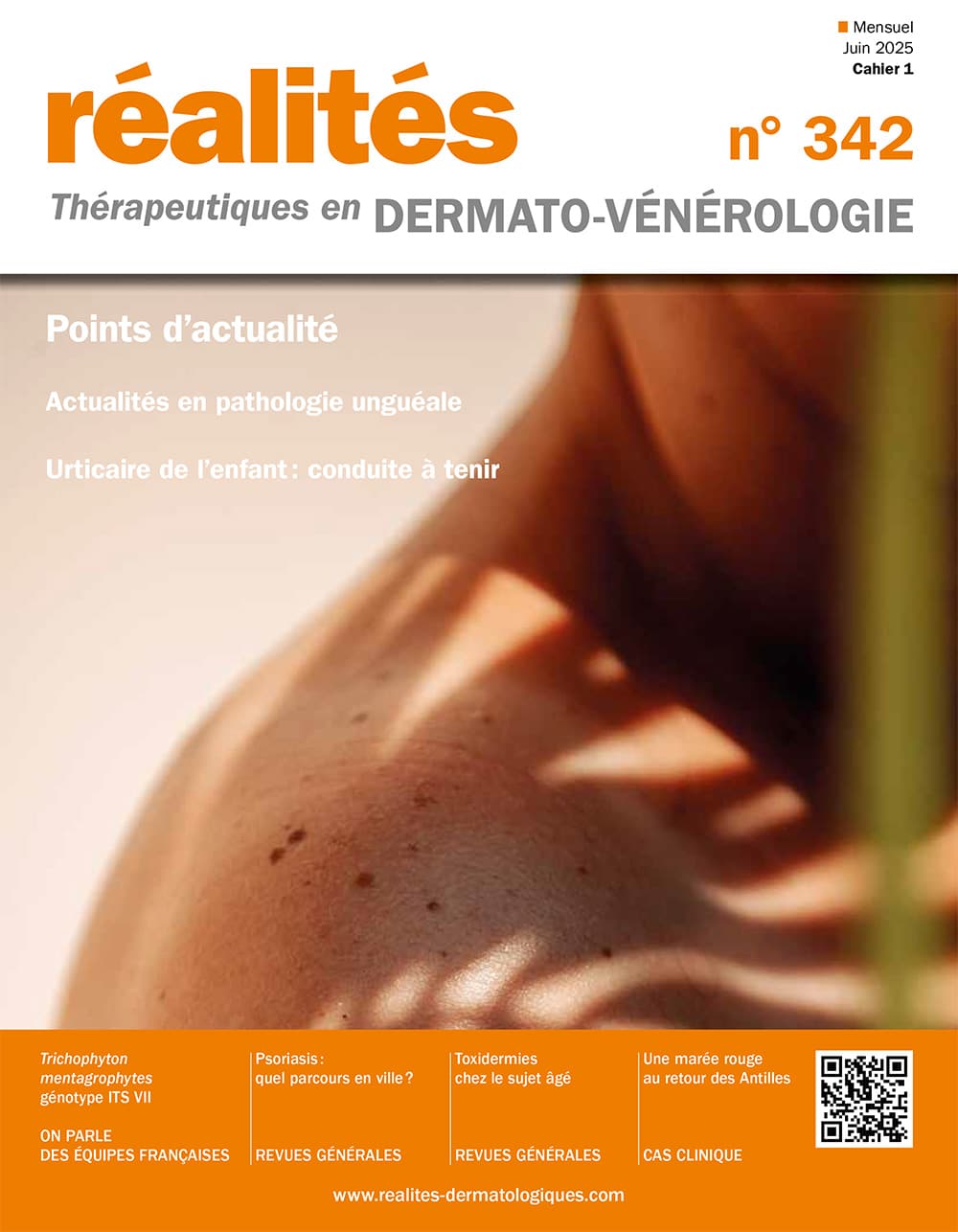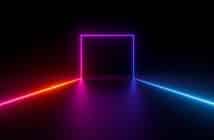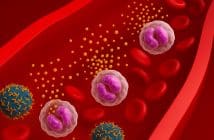- Les cryoglobulinémies : introduction et définition
- Les vascularites cryoglobulinémiques : présentation clinique
- 1. Atteintes cutanées
- 2. Atteintes articulaires
- 3. Atteintes rénales
- 4. Atteintes neurologiques périphériques
- 5. Les autres manifestations sont beaucoup plus rares (< 5 %) >>> Atteinte digestive
- Les autres cryoprotéinémies
- Les anomalies biologiques et anatomopathologiques
- Étiologies des cryoglobulinémies
- 1. Les cryoglobulinémies de type I
- 2. Les cryoglobulinémies mixtes (types II ou III)
- Pronostic et traitement
Les cryoglobulinémies : introduction et définition
Les cryoglobulinémies sont définies par la présence persistante dans le sérum d’immunoglobulines (Ig) anormales qui ont la propriété de précipiter au froid et de se solubiliser à nouveau lors du réchauffement. Cette définition permet de distinguer les cryoglobulinémies des autres cryoprotéines : les cryofibrinogènes (CF) et les agglutinines froides.
Depuis 1974, la classification de Brouet et al. [1] est la plus utilisée et repose sur une analyse immunochimique des cryoglobulinémies permettant de définir trois types :
- les cryoglobulinémies de type I composées d’une immunoglobuline monoclonale unique, le plus souvent de
type IgM ou IgG ; - les cryoglobulinémies de type II composées d’immunoglobulines polyclonales associées à un ou plusieurs constituants monoclonaux. Le plus souvent, l’Ig monoclonale est une IgM associée à des IgG polyclonales (cryoglobulinémie mixte monoclonale). Isolée séparément, aucune de ces Ig ne précipite au froid. L’IgM monoclonale a une activité facteur rhumatoïde et se lie à la fraction Fc des IgG. Ces nombreuses interactions chimiques confèrent une grande stabilité au[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire