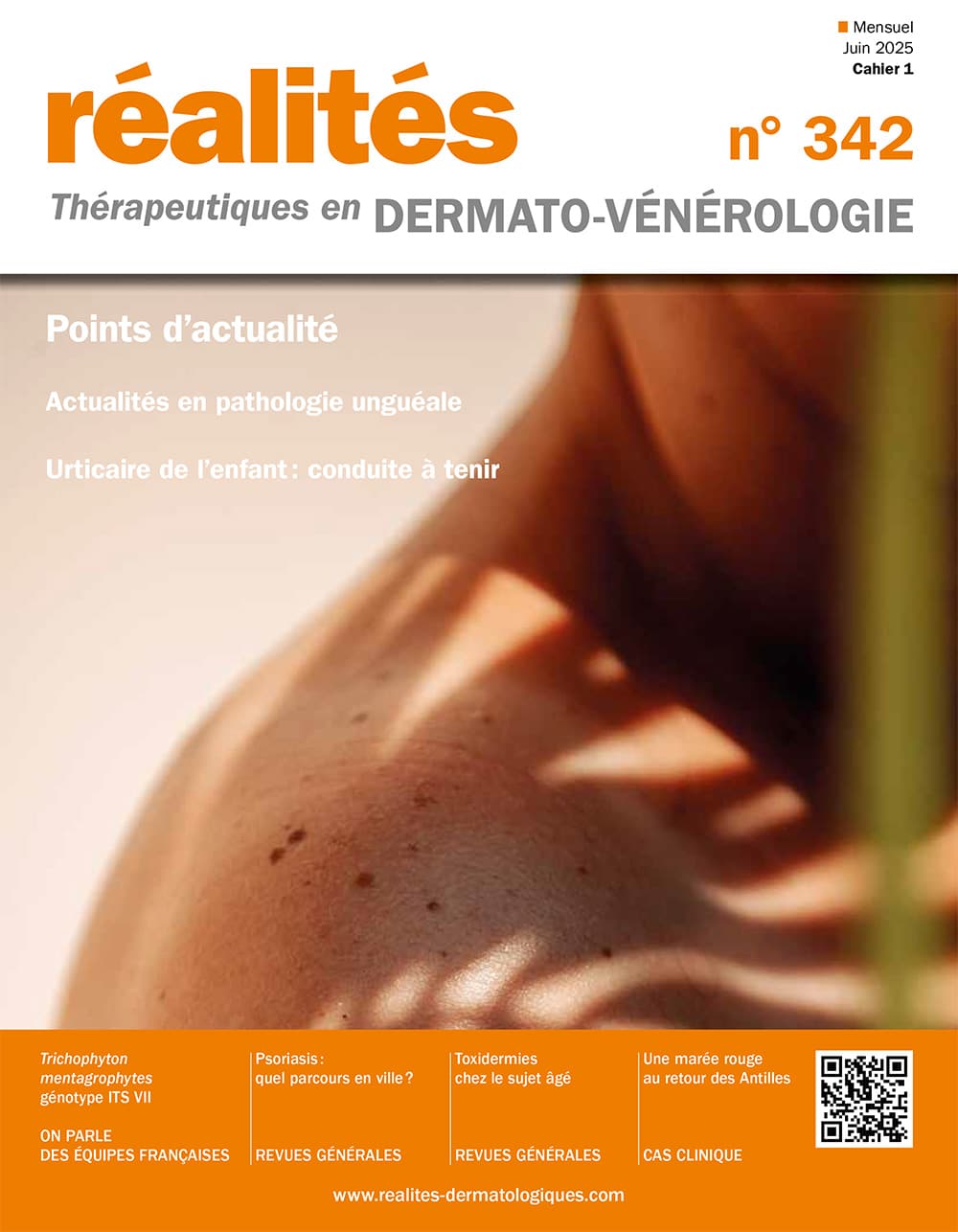- Classification des pansements (tableau I)
- 1. Hydrocolloïdes
- 2. Alginates
- 3. Hydrofibres
- 4. Hydrogels
- 5. Hydrocellulaires
- 6. Pansements au charbon
- 7. Films adhésifs transparents
- 8. Tulles et interfaces
- 9. Pansements à l’argent
- Les recommandations HAS (2011)
- Les pansements “booster”
- 1. Antiprotéases
- 2. Pansements à l’acide hyaluronique
- Les techniques innovantes
- 1. La thérapie par pression négative
- 2. L’électrostimulation
- 3. La larvothérapie
“Je panse donc je suis”, tel est le titre d’une bande dessinée de Cauvin [1]. Il reflète de façon ironique l’expérience et la compétence des infirmier(ère)s dans le domaine de l’art du pansement. Cet acte de panser une plaie est aussi vieux que l’humanité, traversant les guerres et s’enrichissant des progrès de la compréhension sur la cicatrisation.
La plupart des pansements sont destinés à favoriser la cicatrisation en milieu humide. Les hydrocolloïdes, apparus au début des années 1980, peuvent être considérés comme le modèle de ces -pansements, généralement dénommés pansements “modernes”. En revanche, les pansements vaselinés les plus anciens font, eux, partie des pansements dits “conventionnels” (qui comprennent également les pansements en coton, les compresses humides, etc.).
Longtemps basée sur l’expérience, l’utilisation des pansements est désormais soumise à l’évaluation par la preuve. En conséquence, ces dernières années ont vu l’apparition d’études cliniques comparatives. Le dermatologue, en tant qu’expert de la physiologie et des pathologies cutanées est l’acteur de choix pour guider la prise en charge d’une plaie, s’aidant des techniques modernes.
L’art de panser consiste donc à appliquer le bon pansement[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire