
Que doit savoir le dermatologue sur les actualités en génétique ?
La génétique médicale est entrée dans l’ère de la génomique depuis l’accessibilité au séquençage à très haut débit. Ces progrès technologiques permettent de lutter contre l’impasse diagnostique et offrent la possibilité d’apporter un conseil génétique à de plus nombreuses familles.
Les génodermatoses regroupent plusieurs centaines de pathologies, décrites principalement par leurs caractéristiques cliniques. Toutefois, l’hétérogénéité, à la fois clinique et génétique, suggère parfois de nouvelles classifications en lien avec l’origine génétique commune.
Il est donc aujourd’hui essentiel pour les dermatologues de connaître les techniques d’analyse génétique, savoir éventuellement les prescrire mais surtout en connaître les limites.

Un érythème des mains et des pieds
Une femme de 31 ans, infirmière en pédiatrie, consulte pour l’apparition depuis 3 jours d’un érythème acral des mains et des pieds.
Elle a présenté avant l’éruption des symptômes pseudo-grippaux à type de fébricule, asthénie et myalgies.
Cet érythème s’accompagne d’arthralgies intenses des extrémités handicapant la mobilité, sans arthrite ni synovite.
Vous constatez un érythème en nappes, finement purpurique, affectant les mains et pieds et remontant aux poignets et tiers inférieurs des jambes.
Quel diagnostic proposez-vous ?

Télédermatologie en pédiatrie, une optimisation du parcours de soins ?
La télémédecine fait partie de notre quotidien en 2024. La dermatologie a été motrice dans le développement de nouvelles solutions, tant par téléconsultations (TC) (consultation face-face avec un patient par écran interposé) ou télé-expertises (TE) (dossiers médicaux entre médecins, déposés sur des sites dédiés avec analyse asynchrone). Ces nouvelles solutions doivent respecter des règles strictes : activité intégrée dans le dossier médical (identité, rédaction d’observation, archivage, etc.) et règles informatiques strictes.
Le service de dermatologie d’Argenteuil, pionnier depuis 2013 en télédermatologie, a développé six solutions destinées à la pédiatrie permettant de répondre à de nombreuses sollicitations : TE avec les centres pénitentiaires pour mineurs, TE interhospitalière, TE de proximité et TE avec la pédiatrie africaine francophone ; enfin TC du quotidien, mais aussi dédiée aux nageurs “Élite” franciliens.
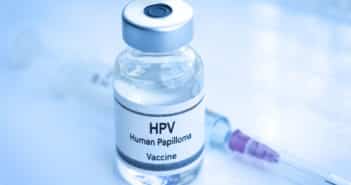
Vaccination dirigée contre les HPV : mise au point
Les papillomavirus humains du genre alpha (α-HPV) oncogènes sont impliqués dans les cancers anogénitaux et ORL avec une fréquence variable selon les sites anatomiques : 99,9 % des cancers du col de l’utérus, 90 % des cancers de l’anus, 50 % des cancers du pénis, 30 % des cancers de l’oropharynx et 40 % des cancers de la vulve.
En France, deux vaccins sont disponibles : une vaccin nonavalent (Gardasil 9) et un bivalent (Cervarix), avec une recommandation claire pour l’utilisation du vaccin nonavalent en raison de sa couverture plus large. L’âge idéal pour vacciner se situe entre 11 et 14 ans, pour les filles comme pour les garçons, mais en l’absence de vaccination, l’adolescent peut tout de même bénéficier de ce vaccin jusqu’à l’âge de 19 ans. Un rattrapage vaccinal est aussi prévu pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu’à 26 ans, bien que la communauté médicale plaide pour une généralisation de cette extension d’âge à toute la population sans distinction de sexe ni d’orientation sexuelle.

Prise en charge des situations difficiles dans l’acné
L’acné est une pathologie fréquente. Il existe une grande variabilité des présentations cliniques. Certaines acnés peuvent être difficiles à traiter, car persistantes ou réfractaires aux traitements conventionnels. Cela peut être le cas d’acnés sévères : acné fulminans, acné conglobata et formes frontières avec l’hidradénite suppurée ou d’acnés plus modérées mais chroniques et récidivantes.
D’autres acnés peuvent être difficiles à diagnostiquer et à prendre en charge car s’intégrant dans des syndromes plus complexes comme le SAPHO ou le spectre du PAPA syndrome.
La reconnaissance de ces formes particulières d’acné difficile est importante pour adapter notre prise en charge.

Dermatite atopique de l’adulte : que faire après l’échec des traitements conventionnels ?
Actuellement, différentes classes thérapeutiques sont disponibles pour la prise en charge de la DA modérée à sévère. La ciclosporine est le traitement systémique de 1re intention, les biothérapies (dupilumab et tralokinumab) et les inhibiteurs de JAK (baricitinib, abrocitinib et upadacitinib) étant indiqués en cas d’échec, de contre-indication ou d’intolérance à la ciclosporine. Du fait d’un mode d’action distinct, les biothérapies et les inhibiteurs de JAK ont un profil d’efficacité et de tolérance différent, permettant d’adapter le traitement aux comorbidités et aspirations du patient.

Urticaire chronique spontanée : perspectives thérapeutiques
L’urticaire chronique spontanée (UCS) est une pathologie fréquente qui a vu sa prise en charge révolutionnée depuis une dizaine d’années par l’arrivée de l’omalizumab. Les recommandations européennes successives proposent une prise en charge thérapeutique claire en trois paliers : antihistaminiques, omalizumab, ciclosporine. Il reste des besoins médicaux non couverts par l’omalizumab. La meilleure compréhension de la physiopathologie de l’UCS permet de définir de nouvelles cibles thérapeutiques et des molécules innovantes sont en cours de développement, telles que les inhibiteurs de tyrosine kinase de Bruton (remibrutinib, fenebrutinib), les anti-Siglec8 (lirentelimab) ou encore les inhibiteurs de C-kit (barzolvolimab, briquilimab).

Un purpura aigu du nourrisson… finalement bénin
Léa, âgée de 6 mois, est hospitalisée en urgence en pédiatrie en raison de l’apparition de novo depuis 24 h de lésions cutanées purpuriques ecchymotiques siégeant principalement en regard des faces convexes des joues et oreilles. Quatre autres lésions rondes purpuriques siègent de façon asymétrique sur le tégument.

Dermatite atopique : et s’il existait une dermatite de contact surajoutée ?
La dermatite atopique est une dermatose inflammatoire chronique fréquente. Rencontrée surtout chez l’enfant, mais également chez l’adulte, elle évolue par poussées. Son diagnostic est aisé dans la plupart des cas et essentiellement basé sur des critères anamnestiques et cliniques.
Cependant, chez un nombre non négligeable de patients, d’autres dermatites (inflammatoires, métaboliques, infectieuses, liées à un déficit immunitaire, voire néoplasiques) peuvent donner le change et induire le clinicien en erreur.
D’autre part, il n’est pas exceptionnel que la dermatite atopique se complique d’une dermatite allergique de contact qui, très souvent, peut passer inaperçue en raison de critères sémiologiques très proches et/ou d’applications de corticoïdes locaux qui laissent souvent évoluer la sous-jacente de manière insidieuse et à bas bruit. Il convient également de souligner que le patient atteint de DA est fortement sujet au développement d’une dermatite irritative de contact, en particulier au visage et au dos des mains.

Douleur neuropathique chronique sur cicatrice : traitement transdermique par capsaïcine
L’augmentation notable des cas de cancers de la peau entraîne une demande croissante de procédures chirurgicales dermatologiques non esthétiques. Bien que la chirurgie dermatologique ne soit pas décrite comme à haut risque, la douleur chronique post-chirurgicale (DCPC) en est une complication possible impactant la qualité de vie des patients. La DCPC est liée à des altérations traumatiques nerveuses survenant au cours de la chirurgie et à des phénomènes inflammatoires locaux pouvant conduire à un phénomène de sensibilisation centrale [1]. Les traitements classiques de la douleur neuropathique sont parfois insuffisants et peuvent être sources d’effets indésirables importants ou de mésusage. La capsaïcine à haute concentration transdermique, par son mode d’action et sa tolérance, constitue une alternative thérapeutique intéressante dans la prise en charge des DCPC en dermatologie.





