
Recommandations européennes par consensus interdisciplinaire, pour le diagnostic, le traitement et la prévention des kératoses actiniques
Ces recommandations abordent l’épidémiologie, le diagnostic, la stratification des risques et les traitements chez les patients immunocompétents et immunodéprimés atteints de kératoses actiniques (KA). Les KA sont des précurseurs potentiels du carcinome épidermoïde cutané (CEC) et présentent des caractéristiques histopathologiques et immunohistochimiques typiques de cette tumeur maligne à un stade précoce. Elles peuvent évoluer en CEC in situ et devenir invasives dans un faible pourcentage de cas. Le diagnostic de KA et de champs de cancérisation repose sur l’examen clinique. La dermatoscopie, la microscopie confocale, la tomographie par cohérence optique ou la tomographie confocale peuvent aider au diagnostic différentiel de la KA et des autres cancers cutanés. Une biopsie est indiquée en cas de lésions cliniquement et/ou dermatoscopiquement suspectes et/ou réfractaires au traitement. Le choix du traitement dépend des caractéristiques du patient et de la lésion. Pour les lésions uniques non hyperkératosiques, le traitement peut être débuté à la demande du patient par des traitements destructeurs ou des traitements topiques. Pour les lésions multiples, un traitement du champ de cancérisation est conseillé par des traitements topiques ou une photothérapie dynamique (PDT). Des mesures préventives telles que la protection solaire, l’auto-examen et des traitements répétés du champ de cancérisation sont conseillées chez les patients à haut risque.

Rôle du dermatologue-vénérologue dans la santé sexuelle des adolescents
Il est noté de façon récente une augmentation des cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) chez les femmes en âge de procréer et les adolescents. Parallèlement, une diminution de la crainte de l’infection par le VIH et des IST d’une façon générale est constatée, celle-ci s’accompagnant d’une baisse du niveau des connaissances sur les IST et le VIH par les adolescents. Actuellement, un jeune Français sur deux seulement est préoccupé à l’idée de contracter une IST. L’implication du dermatologue dans la prévention, le dépistage et la prise en charge des IST et de la santé sexuelle des adolescents a décliné depuis plusieurs années. Les principales raisons sont un manque de formation et de pratique. Paradoxalement, le dermatologue est l’un des professionnels de santé les plus fréquemment consultés par la tranche d’âge 12-25 ans.

Traitement du vitiligo par l’association corticoïdes et méthotrexate
Le vitiligo est une pathologie cutanée dépigmentante auto-immune chronique, caractérisée par la perte de mélanocytes, affectant 0,5 à 1 % de la population mondiale. Les options thérapeutiques restent limitées. La prise en charge du vitiligo peut donc s’avérer être un véritable challenge thérapeutique. La découverte de nouvelles lignes de traitements est importante pour cette pathologie qui impacte particulièrement la qualité de vie des patients. La séquence corticothérapie mini-pulse et méthotrexate associée à la photothérapie pour la prise en charge de vitiligos non segmentaires pourrait permettre un arrêt de la dépigmentation, une repigmentation et le maintien de celle-ci chez des patients souffrant d’un vitiligo généralisé sévère actif, avec une surface cutanée atteinte parfois importante.

Conduite à tenir devant des taches café-au-lait multiples de l’enfant
Les taches café-au-lait (TCL) se définissent comme des macules brunes uniformément pigmentées, typiquement rondes ou ovales, congénitales ou apparaissant au cours des premières années de vie. Elles peuvent constituer un marqueur précoce d’affections génétiques, au premier plan la neurofibromatose de type I. Le syndrome de Legius, la neurofibromatose de type II, le syndrome de Noonan avec lentigines multiples et le syndrome de déficience constitutionnelle des gènes MMR (CMMRD, pour Constitutionnal mismatch repair deficiency) peuvent également être révélés par des TCL multiples. La démarche diagnostique en cas de TCL multiples devra prendre en compte leur nombre et leur caractère typique ou non, l’âge de l’enfant ainsi que les éventuels antécédents familiaux de TCL. L’indication d’analyse génétique moléculaire devra être discutée au cas par cas dans le cadre d’un avis collégial pris dans un centre de compétence/référence des maladies rares dermatologiques et génétiques.

Questions flash – Pathologies des muqueuses
Les chéilites sont des inflammations des lèvres mais, par extension, ce terme désigne souvent une affection des lèvres, quelle que soit la forme clinique. Cet article se concentrera sur une classification clinique des chéilites, en mettant en avant les principaux diagnostics différentiels des macrochéilies, et macrochéilites, chéilites desquamatives et croûteuses, chéilites érosives et ulcérées, chéilites pigmentées, chéilites actiniques et kératosiques.

Diagnostic et traitement des lésions des muqueuses à HPV de l’homme et de la femme (condylomes, néoplasies)
La papillomavirus humain (HPV) est un virus à ADN de 8 000 paires de base. Il existe plus de 200 génotypes d’HPV. Au niveau génital, les génotypes responsables des lésions bénignes ou condylomes sont les génotypes 6 et 11. Les lésions de haut grade et les cancers HPV induits sont majoritairement des génotypes 16 et 18 dans plus de 90 % des cas [1]. On notera qu’il s’agit d’un virus très répandu dans la population, et on considère que plus de 80 % des personnes ont rencontré le virus dans les 2 ans après le début de la vie sexuelle.
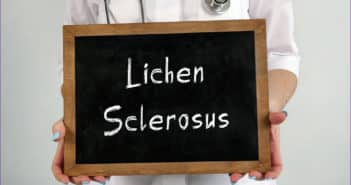
Lichen scléreux génital homme et femme : regards croisés
Le lichen scléreux (LS) est une dermatose inflammatoire chronique, touchant avec prédilection la région génitale. Les synonymes anciens sont à abandonner : kraurosis vulvae, balanitis xerotica obliterans, lichen scléro-atrophique, balanite scléreuse oblitérante.
La prévalence du LS génital est estimée à 3 % ou plus chez les femmes et à 0,07 % chez les hommes [1]. Les femmes sont donc plus souvent atteintes que les hommes, avec un sex-ratio variant de 3 à 10:1 selon les études [2].
L’étiologie du LS génital n’est pas connue et débattue. Chez la femme, la maladie est considérée comme auto-immune, le LSV étant significativement associé à d’autres pathologies auto-immunes [3]. Chez l’homme, au contraire de la femme, la physiopathologie du LS reposerait moins sur des facteurs auto-immuns que sur le rôle irritatif de l’urine macérant entre le gland et le prépuce [4].

Le lichen plan buccal : une pathologie encore mal connue
Le lichen oral est une maladie complexe, compliquée par plusieurs facteurs :
– la classification nosologique reste ambiguë ;
– il existe une grande variété de lésions évoluant avec la maladie ;
– les lésions peuvent apparaître dans différentes localisations ;
– la plupart des traitements sont basés sur des niveaux de preuves limités.
Classification nosologique du lichen plan : lichen plan oral et réactions lichénoïdes (tableau I) [1]
Le terme “lichen oral” regroupe trois entités : le lichen plan oral (LPO), les lésions lichénoïdes orales (LLO), et les lésions lichénoïdes orales induites (LLOI).
Acné de l’adolescent : actualités
L’acné touche 85 % des adolescents (12-25 ans). À cette période de la vie, elle peut avoir un impact très important sur l’image de soi, la confiance en soi et sur la relation avec les autres. Elle expose aux risques de stigmatisation, dysmorphophobie et cosmétorexie.
Au travers d’études descriptives récentes, il a été observé que les adolescents recherchent des informations sur l’acné en questionnant leur famille, leurs amis mais aussi et surtout via les réseaux sociaux. On sait que l’information sur ces réseaux n’est pas toujours validée, ce qui peut véhiculer des croyances incomplètes voire erronées comme, par exemple, que l’acné est liée à un défaut d’hygiène. Par ailleurs, ces études montrent que leur connaissance de l’acné est partielle : les ados pensent souvent que l’acné est transitoire et non une pathologie chronique.

Questions flash – Dermatologie pédiatrique
Les anomalies vasculaires comprennent un groupe hétérogène de lésions regroupant les tumeurs vasculaires, représentées principalement par les hémangiomes infantiles, généralement peu compliqués et faciles à gérer ; et les malformations vasculaires qui sont rares et ne font pas l’objet de recommandations. La classification proposée par l’International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) en 1998 et mise à jour en 2018, divise les anomalies vasculaires en tumeurs vasculaires et malformations vasculaires sur des critères cliniques, radiologiques, histologiques et moléculaires. Elle distingue les malformations vasculaires “simples” (de bas débit ou haut débit), “combinées”, “tronculaires” et celles “associées à d’autres anomalies”.





