
Quoi de neuf en dermatologie esthétique ?
L’année écoulée a été un peu particulière : pas ou peu de congrès scientifiques, beaucoup de webinars de qualité très variable (certains de faible qualité mais d’autres très formateurs), dynamisme des forums de discussion… Et un sujet récurrent dans la presse médicale : COVID et injections.

Quoi de neuf dans l’acné ?
L’acné est une pathologie fréquente et chronique qui peut avoir un retentissement psychologique important sur les patients et leur famille. Sa pathogénie est complexe et fait intervenir des facteurs inflammatoires, hormonaux, génétiques et environnementaux. La prise en charge de l’acné continue d’évoluer avec de nouvelles molécules disponibles et de récentes études et publications pour optimiser l’utilisation des thérapies connues.

Quoi de neuf en pathologie unguéale ?
En ce qui concerne notre discipline, l’année thérapeutique aura été marquée en 2021 par la multiplication des modifications inhabituelles de l’appareil unguéal occasionnées par l’infection à SARS-CoV-2. Devant les conséquences parfois imprévisibles de cette maladie, nous avons pensé que son intérêt dépassait fortement celui des dermatoses unguéales, isolées ou associées à divers syndromes. Pour cette année, elle sera donc notre invitée d’honneur.

État des lieux sur les anti-IL23 dans le traitement du psoriasis en plaques
La prise en charge du psoriasis en plaques de stade modéré à sévère a été complètement révolutionnée par l’émergence des biothérapies. Le contrôle de l’inflammation chronique, l’amélioration de la qualité de vie et une prise en charge globale du patient, de ses symptômes et de ses comorbidités deviennent un enjeu crucial. L’utilisation de nouvelles classes thérapeutiques à l’instar des inhibiteurs de l’interleukine 23 (anti-IL23) pourrait permettre d’affiner les stratégies de traitement notamment par le biais de gains d’efficacité et de maniabilité. Un état des lieux concernant l’efficacité, la tolérance et les données de rémanence de cette classe thérapeutique majeure est présenté dans cet article.

Actualités sur les nouveaux syndromes auto-inflammatoires
Les syndromes auto-inflammatoires regroupent un ensemble de pathologies caractérisées par une inflammation clinico-biologique et résultant de l’implication de molécules de l’immunité innée en l’absence d’infection ou d’auto-immunité. Depuis une dizaine d’années, la “révolution” des techniques modernes de biologie moléculaire a permis l’identification de nouvelles mutations, permettant ainsi d’en bouleverser la nosographie générale et de guider les pistes thérapeutiques futures. Les exemples sont nombreux : haplo-insuffisance A20, syndrome VEXAS, déficit en ADA2…
Nous nous concentrons ici sur les nouveautés de ce champ immense dans la pratique du dermatologue, en nous attardant sur les concepts globaux, les apports récents de la biologie moléculaire et les dernières entités décrites.
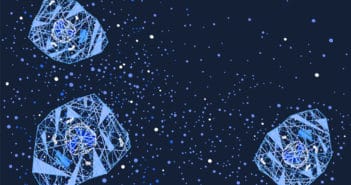
Syndrome d’orage cytokinique : un concept d’actualité
La COVID-19 peut provoquer un large éventail de manifestations cliniques allant de formes asymptomatiques chez 30 % des individus à des formes bénignes ou modérées associant fièvre, toux, myalgies chez 55 % des individus et des formes sévères parfois fatales. Les patients atteints de COVID-19 sévère présentent un profil immunologique particulier, caractérisé par une réponse immunitaire innée excessive avec hypersécrétion de cytokines pro-inflammatoires appelée orage cytokinique et une réponse interféron de type I défaillante. L’ensemble de cette cascade immunologique conduit au syndrome de détresse respiratoire aigu, à une défaillance multiviscérale et au décès.
De nombreux traitements ont été évalués pour diminuer la mortalité de ces patients sévères.
Aujourd’hui, la dexaméthasone réduit la mortalité de 30 % chez les patients sous assistance respiratoire et de 20 % chez les patients sous oxygénothérapie. Deux anticorps monoclonaux (casirivimab-
imdevimab et regdanvimab) sont destinés aux patients qui présentent des risques de développer des formes graves de la maladie. Un traitement oral (l’association nirmatrelvir/ritonavir) vient d’être approuvé en Europe.
Les mesures barrières et la vaccination restent le premier rempart face à cette épidémie, à ses conséquences désastreuses sur la santé et sur l’économie mondiale.

Prise en charge de la dermatite atopique de l’enfant
La dermatite atopique est une maladie fréquente chez l’enfant qui s’accompagne d’un impact majeur sur la qualité de vie des patients et de leur famille. Les patients sont souvent insuffisamment traités en raison de croyances qui perturbent l’adhésion thérapeutique. Le traitement de base repose sur les soins locaux : dermocorticoïdes et émollients. La prise en charge globale d’un patient atteint de dermatite atopique et de sa famille devrait intégrer une éducation thérapeutique. Les traitements systémiques immunosuppresseurs (ciclosporine, méthotrexate) sont exceptionnellement utilisés chez l’enfant (hors AMM). Le dupilumab est la première biothérapie à avoir l’AMM dans la dermatite atopique à partir de 6 ans.

Fiche de dermoscopie n° 20
Il s’agit d’un homme de 48 ans, de phototype IIIb avec une bonne aptitude au bronzage. Il n’a jamais vécu outre-mer, n’a jamais fait d’UV artificiels, son activité professionnelle est à 100 % intérieure et ses loisirs ensoleillés sont modérés. Il n’a pas d’antécédent personnel ou familial cancérologique. Il ne prend aucun médicament et n’a jamais reçu de traitement au long cours dans sa vie.

La peau et l’allergie à l’arachide : implications de l’étude LEAP
La dermatite atopique est une maladie inflammatoire de la peau qui évolue sur un mode chronique, le plus souvent associée à d’autres phénotypes de l’atopie tels que l’asthme, la rhinite allergique et l’allergie alimentaire (AA). L’étude LEAP (Learning About Peanut Allergy) a montré une réduction significative du risque de développer une AA à l’arachide chez les nourrissons atteints d’eczéma sévère et/ou d’allergie à l’œuf ayant bénéficié de l’introduction précoce de protéines d’arachide entre les âges de 4 et 11 mois.
Cet article évalue les conséquences de l’étude LEAP, y compris sa faisabilité chez les enfants nourris au sein, les avantages de l’introduction précoce de divers aliments “allergisants” usuels entre 4 et 6 mois et les effets éventuels d’une restauration de la fonction barrière de la peau par l’application d’émollients, associés ou non à l’introduction précoce des aliments.

Pigmentation correctrice après chirurgie plastique : la solution dermo-esthétique pour dissimuler les cicatrices
La dermopigmentation des cicatrices est une alternative douce et efficace au traitement des cicatrices postopératoires. Elle peut être pratiquée dans de nombreuses indications : cicatrices de chirurgies mammaires, de lifting et de fentes labiales, post-mastectomie, mais aussi pour redessiner voire recréer des aréoles mammaires.
La dermopigmentation est différente du tatouage. Plus superficielle, elle n’est pas définitive et nécessite des retouches régulières. La profession n’étant pas réglementée, il est conseillé de faire appel à des dermo-praticiens reconnus, d’autant plus que la qualité du matériel et des pigments utilisés peut impacter le résultat, qui plus est sur une peau déjà fragilisée.





