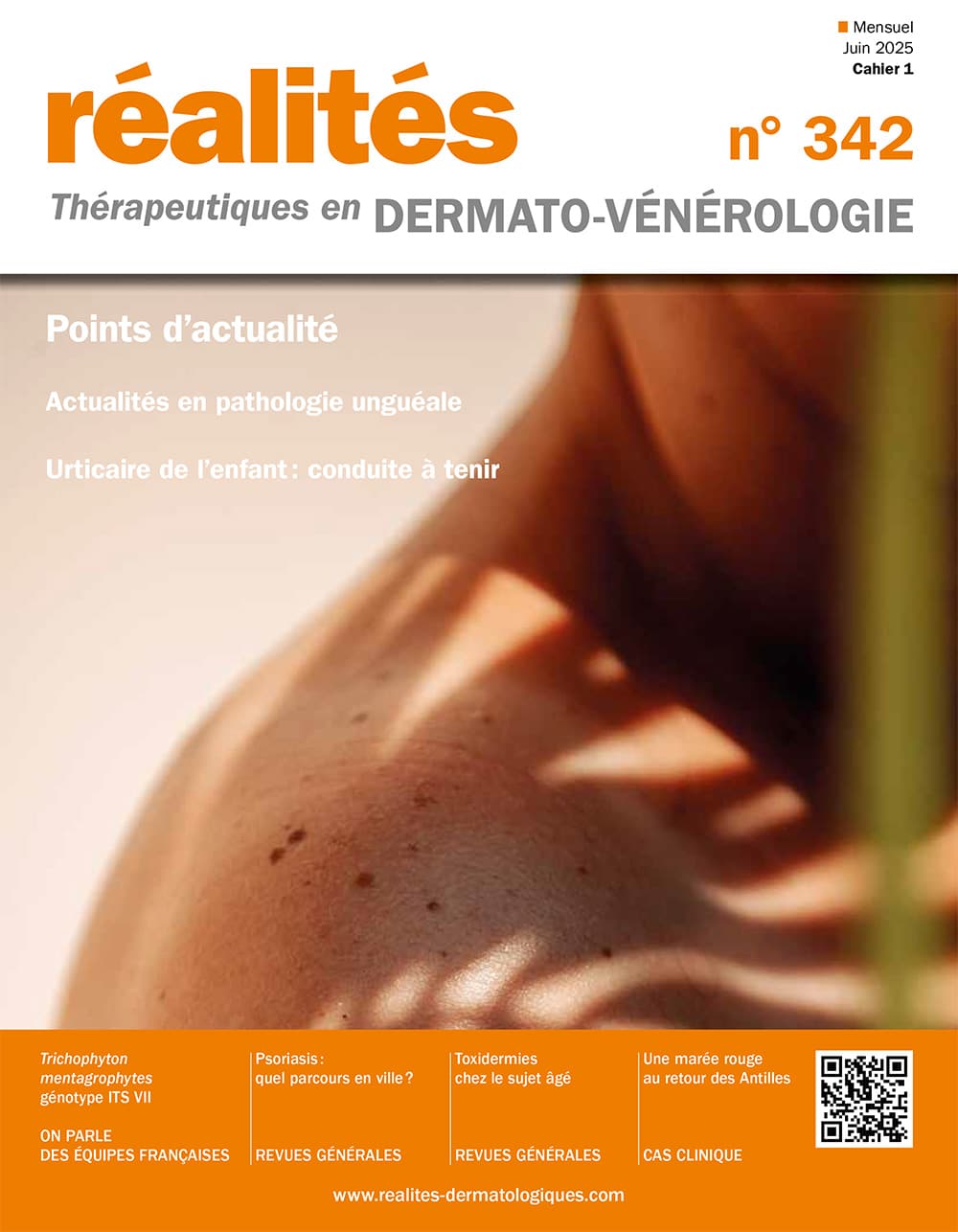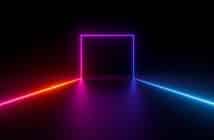- Données épidémiologiques récentes
- Outils d’évaluation clinique et paraclinique de l’activité
- Mécanismes physiopathologiques : état des lieux des connaissances
- Prise en charge thérapeutique : recommandations et traitements innovants
- Avancées dans l’évaluation du retentissement et de la qualité de vie
- Conclusion
Les morphées, également appelées sclérodermies localisées, désignent un groupe de maladies caractérisées par une fibrose affectant la peau et parfois les tissus sous-jacents (fascia, muscle, voire os dans les formes profondes). Contrairement à la sclérodermie systémique, avec laquelle elles partagent des similitudes cliniques et une physiopathologie en partie commune, l’atteinte extracutanée est généralement absente. Pourtant, leur impact clinique peut être majeur, avec un risque de séquelles esthétiques et fonctionnelles important et un retentissement psychosocial majeur. L’objectif de cette revue est de rassembler l’ensemble des données récentes de la littérature portant sur l’épidémiologie, la physiopathologie, les modalités diagnostiques, les avancées thérapeutiques et la gestion de la qualité de vie dans cette pathologie rare pour laquelle le dermatologue est en première ligne.
Données épidémiologiques récentes
Plusieurs travaux récents se sont attachés à préciser l’incidence et la prévalence des morphées. Une étude récente [1] a analysé deux registres nord-américains pour estimer l’incidence et la prévalence de la maladie en population générale. Cette étude rapporte des taux d’incidence compris entre 1,37 et 1,49 cas pour 10 000 habitants par an, sensiblement plus élevés que les précédentes estimations (environ 0,27 cas pour 10 000 habitants par an). La prévalence était, quant à elle, estimée entre 4,08 et 6,58 cas pour 10 000 habitants.
Dans ces mêmes cohortes, deux pics d’incidence se dégagent : l’un dans l’enfance (entre 2 et 14 ans, âge médian de 13,5 ans) et l’autre à l’âge adulte (entre 35 et 50 ans, âge médian de 43 ans), en accord avec les données déjà rapportées dans la littérature [2]. La prédominance féminine est nette, avec un ratio femme/homme variant de 2,6 :[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire