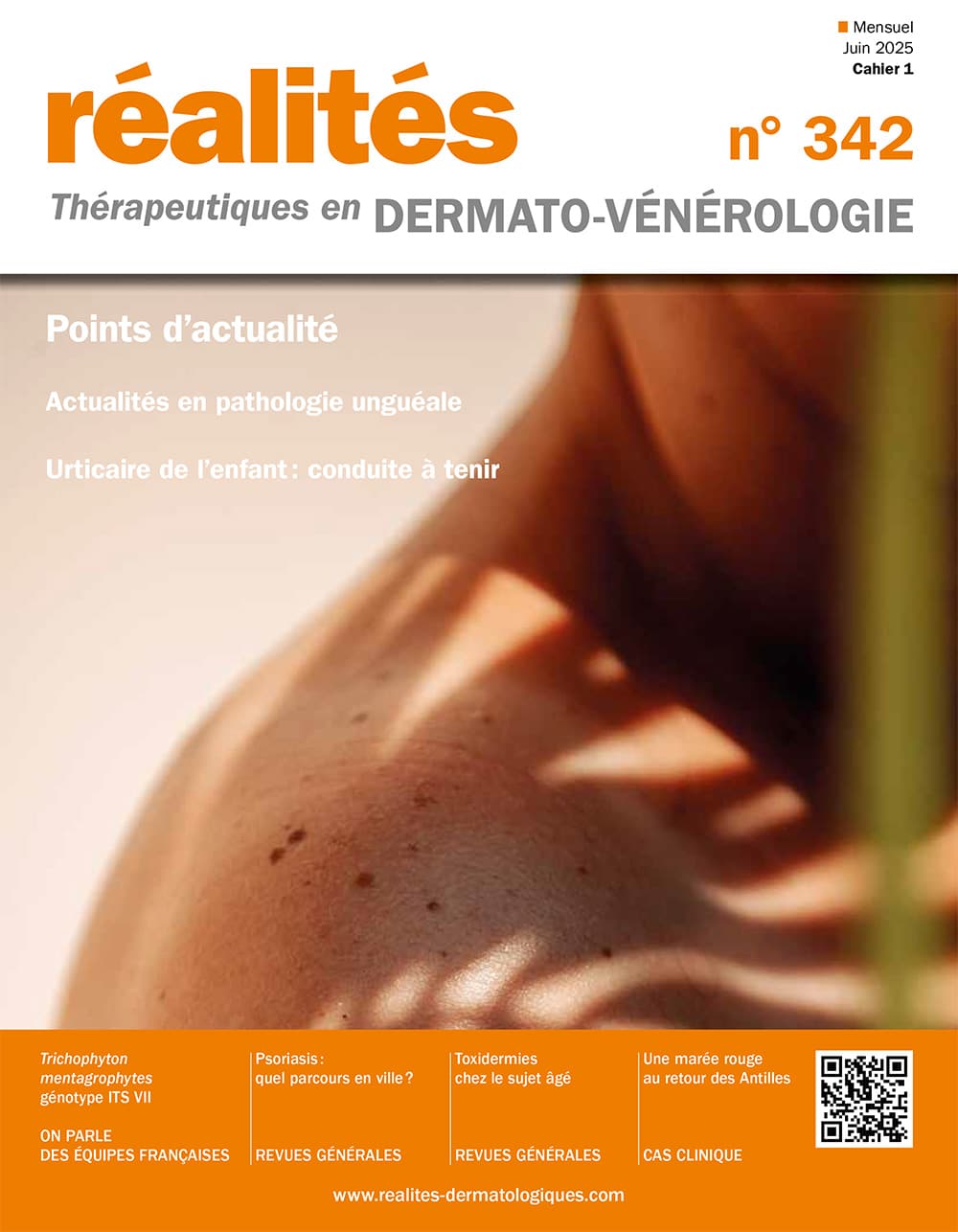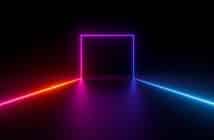La kératose actinique
La KA est un trouble de la différenciation et de la prolifération des kératinocytes induit par l’exposition solaire, et qui est associée au risque de cancer cutané.
C’est un motif fréquent (5 %) de consultation en dermatologie [1]. Ce pourcentage varie selon les continents et en Australie la prévalence est de 40 à 60 % chez les individus de plus de 40 ans [2].
Cette lésion est la conséquence d’une irradiation cumulée aux UV expliquant sa localisation préférentielle dans les zones photoexposées (face, cuir chevelu surtout en cas de calvitie, dos des mains) plus particulièrement chez les personnes à la peau claire et âgées. Les UV sont le principal carcinogène, induisant de nombreuses mutations géniques et favorisant la promotion tumorale en agissant sur les voies cellulaires régulant la prolifération, l’apoptose, l’inflammation et l’immunosuppression impliqués dans la formation de la KA [3]. Le type d’UV en cause sont d’abord les UVB, directement mutagènes sur l’ADN, mais aussi les UVA qui sont en quantité plus importante et produisent des réactifs oxygénés, eux-mêmes mutagènes [4]. Les papillomavirus humains répandus sur la peau sont considérés comme des cocarcinogènes [5].
La présence de lésions de KA au sein des carcinomes épidermoïdes cutanés (CEC) des zones photoexposées, dans plus de 85 % des cas amène à proposer le terme de cancer in situ [6].
Cependant, toutes les KA ne se transforment pas et le risque de transformation dépend de la zone (à risque), d’antécédent de CE, de la multiplicité des lésions avec présence d’un champ de cancérisation, d’un terrain immunodéprimé.
Champ de cancérisation
La notion de “champ de cancérisation” concerne de nombreux cancers. Il s agit en effet de lésions infracliniques autour d’un cancer qui peuvent se transformer [7].
En hépatologie, c’est la cirrhose du foie qui représente le champ de cancérisation. En pneumologie, c’est la bronchite chronique tabagique.
Pour la peau, il s’agit de modifications histologiques et moléculaires UV induites, présentes sur une zone cutanée (typiquement le scalp ou le visage)[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire