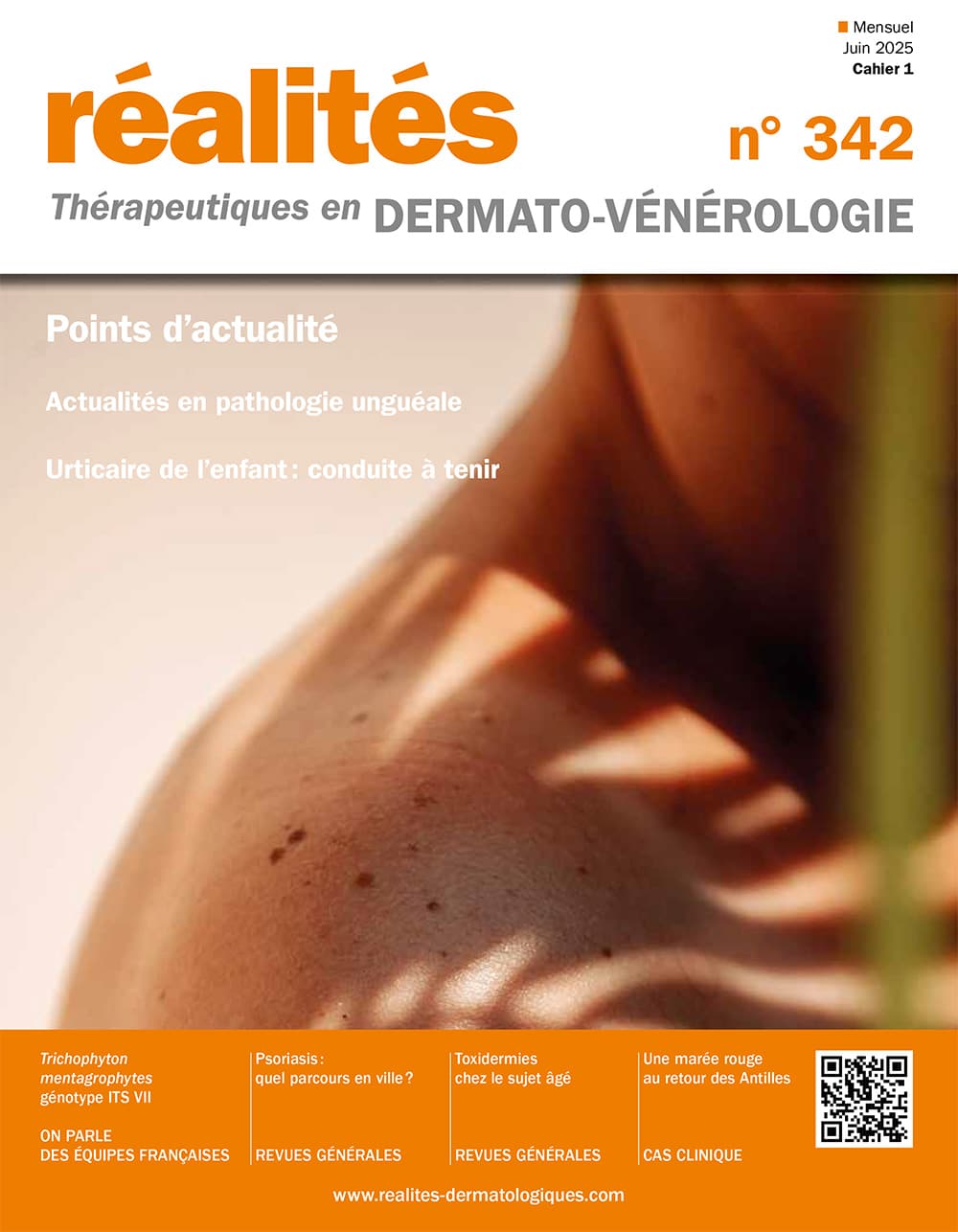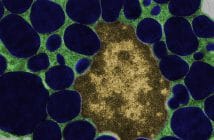Le traitement de l’érythermalgie est parfois simple lorsque celle-ci répond à l’aspirine. En effet, 500 mg d’aspirine peuvent suffire à faire disparaître une crise, et ce pour plusieurs jours. Les effets d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que l’indométacine, ont aussi été rapportés.
Lorsqu’un traitement étiologique est possible, celui-ci permet habituellement de faire disparaître l’érythermalgie. Mais, dans bien des cas, l’érythermalgie répond assez mal au traitement, même antalgique. En effet, il faut souvent utiliser des antalgiques très forts qui peuvent aller jusqu’à la kétamine ou au ziconotide. De très nombreux traitements ont été proposés sans qu’une étude clinique ait pu être conduite contre placebo : les bêtabloquants, les antidépresseurs (surtout la venlafaxine), la lidocaïne, la mexilétine, la capsaïcine (surtout en patch), la gabapentine, la prégabaline, ou même la toxine botulique ou la stimulation neuro-électrique transcutanée.
Devant la souffrance du patient, ces traitements, nombreux et souvent modérément efficaces, justifient pleinement de conduire une recherche active pour comprendre la physiopathologie de cette maladie ou de ce syndrome. L’érythermalgie étant une vasodilatation douloureuse sans inflammation, il apparaît de plus en plus clairement que son origine est neurogène. En effet, des travaux antérieurs ont montré qu’il existait des anomalies de l’innervation des vaisseaux des extrémités chez ces patients et qu’un certain nombre de neuro-médiateurs vasodilatateurs – tels que la substance P, la bradykinine, les prostaglandines ou surtout le CGRP (Calcitonin gene related peptide)– avaient une concentration sanguine et périvasculaire augmentée. Il est de plus en plus admis que l’érythermalgie est une neuropathie des petites fibres.
L’érythermalgie héréditaire est une maladie très difficile à vivre pour les patients, mais elle représente un modèle d’étude ouvrant de nouvelles possibilités thérapeutiques. Moins de 30 familles ont été recensées dans le monde et il semble exister quelques cas sporadiques. Il s’agit d’une maladie autosomique dominante. Il y a une tendance à l’aggravation au fil des générations. Le gène en cause a été identifié : il s’agit de SCN9A. Ce gène est sur le chromosome 2q et code la sous-unité α du canal sodique voltage-dépendant Nav1.7. Ces canaux sont présents essentiellement dans les ganglions rachidiens dorsaux, mais aussi dans les neurones des ganglions sympathiques et dans les terminaisons nerveuses de ces neurones. Les mutations entraînent une modification de la composition de la protéine, ce qui diminue le palier d’activation. Il y a donc un gain de fonction et il en résulte une hyperexcitabilité de ces neurones.
De nouvelles cibles thérapeutiques pourraient être des inhibiteurs de ces canaux sodiques :[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire